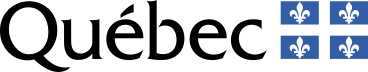Capsules
La personne chargée de la conduite responsable en recherche
Pour mettre en œuvre leur politique sur la conduite responsable en recherche, les établissements désignent une personne en autorité chargée de la conduite responsable en recherche. Cette personne veille à promouvoir une culture de conduite responsable en recherche dans l’établissement, notamment par la formation. Elle est aussi responsable d’encadrer le processus de gestion des allégations pour l’établissement.
Qui est la personne chargée de la conduite responsable en recherche?
C’est une personne qui :
- jouit d’une indépendance et d’une autonomie décisionnelle suffisantes à l’exercice de ses fonctions;
détient un poste en autorité dans l’établissement (poste cadre ou hors-cadre); - est responsable de la gestion des allégations de manquement à la conduite responsable en recherche, incluant le respect de la confidentialité des renseignements personnels que comportent ces dossiers;
- est le principal point de contact avec les Fonds de recherche du Québec (ci-après, FRQ), notamment dans la gestion des allégations de manquement à la conduite responsable en recherche.
Que fait la personne chargée de la conduite responsable en recherche?
- elle est responsable de la promotion de la conduite responsable en recherche au sein de l’établissement ;
elle reçoit les allégations de manquements à la conduite responsable en recherche; - elle gère les étapes du processus de gestion des allégations de manquements à la conduite responsable en recherche (évaluation de la recevabilité de la plainte, mise sur pied du comité d’examen de la plainte) avec discrétion, en faisant preuve de transparence et d’impartialité;
- elle veille au respect de la confidentialité des informations sensibles, dans le respect des lois applicables;
elle communique les informations pertinentes aux FRQ, le cas échéant (lettre de recevabilité de la plainte, rapport d’examen de la plainte ou lettre de conclusion).
Comment puis-je connaître l’identité de la personne chargée de la conduite responsable en recherche dans mon établissement?
Les établissements sont responsables de diffuser et de faire connaître l’identité de la personne chargée de la conduite responsable en recherche, notamment au sein de leur communauté et aux FRQ. Ils sont responsables de s’assurer que les informations concernant l’identité et les coordonnées de la personne chargée de la conduite responsable en recherche soient à jour en tout temps, afin de s’assurer que quiconque souhaite entrer en contact avec cette personne soit dirigée vers la bonne personne!
À titre indicatif, vous trouverez ici la liste des personnes chargées de la conduite responsable en recherche dans les divers établissements qui gèrent du financement provenant des FRQ. Cette liste est le reflet de la situation actuelle, selon les informations transmises aux FRQ.
- Établissements universitaires
- Établissements collégiaux
- Centres intégrés universitaires de Santé et de Services sociaux (CIUSSS)
Pour en savoir plus…
- FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC. Politique sur la conduite responsable en recherche, 2022.
Diffusion : 25 octobre 2016
Les établissements et la conduite responsable en recherche
Les Fonds de recherche du Québec (ci-après, FRQ) font confiance aux établissements pour qu’ils favorisent une culture de la conduite responsable en recherche dans leur milieu. De plus, les FRQ considèrent que les établissements sont les mieux placés pour gérer les allégations qui concernent leurs employés ou leurs étudiants.
Quelles sont les responsabilités des établissements vis-à-vis de la conduite responsable en recherche?
- Promouvoir un milieu qui favorise la conduite responsable en recherche et en assurer la formation continue
Se doter d’une politique sur la conduite responsable en recherche cohérente avec la Politique des Fonds de recherche du Québec - Assurer un usage responsable et éthique des fonds publics
Gérer les allégations de manquement à la conduite responsable en recherche selon les principes de justice naturelle généralement reconnus - Faire le suivi nécessaire pour réduire les conséquences néfastes d’une allégation ou d’un manquement à la conduite responsable en recherche, et porter attention aux personnes en situation de vulnérabilité
Mon établissement est-il concerné par la Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ?
En plus de s’adresser aux personnes qui effectuent la recherche, la politique des FRQ sur la conduite responsable en recherche s’adresse aux établissements qui reçoivent du financement des FRQ, qui en sont fiduciaires ou qui accueillent des activités de recherche financées par les FRQ. Elle décrit notamment, à leur attention, les manquements à la conduite responsable en recherche et les exigences minimales des FRQ en matière de gestion des allégations de manquement. Les établissements qui reçoivent du financement des FRQ, qui en sont fiduciaires ou qui accueillent des activités de recherche financées par les FRQ s’engagent par écrit à les respecter.
Néanmoins, la politique des FRQ invite tous les établissements du Québec où se déroulent des activités de recherche à faire la promotion de la conduite responsable en recherche au sein de leur communauté, et d’ainsi contribuer à l’excellence en recherche!
Pour en savoir plus…
- FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC. Politique sur la conduite responsable en recherche, 2022.
Diffusion : 10 décembre 2015
La conduite responsable en recherche
La conduite responsable en recherche est décrite dans la Politique sur la conduite responsable en recherche, comme se rapportant au :
« (…) comportement attendu des chercheurs et chercheuses, des étudiants et étudiantes, du personnel de recherche et des gestionnaires de fonds lorsqu’ils ou elles s’engagent dans des activités de recherche. Les comportements attendus prennent assise sur des valeurs suivantes : l’honnêteté, l’équité, le respect, la responsabilité et l’ouverture. » (FRQ. Politique sur la conduite responsable en recherche. 2022; p. 12)
Suis-je concerné par la conduite responsable en recherche?
La conduite responsable en recherche concerne toutes les personnes qui contribuent au développement des connaissances par le biais de la recherche. Elle décrit la conduite attendue de tous les chercheurs et chercheuses, les étudiants et étudiantes, le personnel de recherche et les gestionnaires de fonds alors qu’ils mènent des activités de recherche. L’excellence en recherche prend assise sur la conduite responsable en recherche. Cette conduite responsable retient donc de plus en plus l’attention, tant au niveau national qu’international.
Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de la conduite responsable en recherche?
- Je me tiens informé et je participe à l’évolution des meilleures pratiques en conduite responsable en recherche et dans mes activités de recherche
- Je suis en constante réflexion sur mes activités de recherche afin d’adopter une conduite responsable
- J’assure un usage responsable et éthique des fonds publics
- Je collabore dans tout processus de gestion d’une allégation de manquement à la conduite responsable en recherche
- Je suis proactif pour remédier aux conséquences d’un manquement à la conduite responsable en recherche
Pour en savoir plus…
- FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC. Politique sur la conduite responsable en recherche, 2022.
- CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES. Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité de la recherche au Canada, Rapport du comité d’experts sur l’intégrité en recherche, 2010.
- CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCE HUMAINES DU CANADA, CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE DU CANADA et INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA, Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche, 2021.
Diffusion : 7 octobre 2015