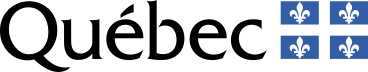Caroline Ménard s’évertue à mieux comprendre la biologie sous-jacente aux réponses au stress chronique, qui peuvent mener à la dépression.
Diagnostiquer la dépression comme on diagnostique un cancer ? Imaginez : il suffirait par exemple de prescrire une prise de sang à un patient lorsqu’il se sent déprimé pour vérifier si ce trouble mental l’affecte. Le cas échéant, le médecin pourrait lui prescrire sur-le-champ des antidépresseurs, qui prennent environ jusqu’à huit semaines pour agir, et ainsi accélérer son rétablissement. S’il n’en tenait qu’à Caroline Ménard, professeure au Département de psychiatrie et de neurosciences de l’Université Laval, ce rêve pourrait un jour se réaliser.
« Nous pensons que l’inflammation joue un rôle majeur dans la dépression. C’est pourquoi nous nous intéressons à des biomarqueurs comme les interleukines, qui régulent entre autres la réponse immunitaire, pour établir une signature de la maladie », explique la chercheuse boursière du Fonds de recherche du Québec − Santé et lauréate du Prix de la jeune chercheuse 2021 du Collège canadien de neuropsychopharmacologie, qui reconnaît les contributions exceptionnelles dans ce domaine de recherche. De fait, la prévalence de la dépression est plus élevée chez les individus qui souffrent d’affections comportant une composante inflammatoire, comme l’obésité et la maladie d’Alzheimer.
Du cerveau à l’intestin
Caroline Ménard est une experte de la biologie de la résilience en matière de stress et des troubles de l’humeur. Si elle s’intéresse tout particulièrement aux processus inflammatoires provoqués par le stress chronique, c’est parce qu’ils s’étendent à l’ensemble du corps et pas seulement au cerveau, comme on l’a longtemps cru. « On sait que de 30 à 50 % des gens répondent peu aux antidépresseurs actuels [qui ciblent surtout les neurones]. Nous essayons de trouver des causes à cette résistance, et l’inflammation systémique engendrée par le stress chronique en fait partie », souligne la scientifique.
Dans son laboratoire affilié au Centre de recherche CERVO, Caroline Ménard évalue les effets du stress chronique sur la barrière hématoencéphalique, cette couche de cellules « étanches » qui tapisse l’intérieur de tous les vaisseaux du cerveau. Pour ce faire, elle mène des expériences sur des souris de laboratoire, puis confirme ses découvertes sur des tissus humains. « Par le passé, nous avons ainsi prouvé que le processus inflammatoire déclenché par un stress social diminue l’étanchéité de cette barrière. La porte est ainsi ouverte à des molécules qui passent dans le cerveau et favorisent l’apparition de symptômes dépressifs », dit-elle.
La chercheuse se penche aussi sur la barrière intestinale et la hausse de sa perméabilité causée par le stress chronique. « Nous étudions l’effet d’une alimentation enrichie en oméga-3 et en sélénium sur la vulnérabilité au stress chez des populations du Nord. Nous voulons clarifier le lien entre le microbiome et l’apparition de troubles de l’humeur », indique la titulaire de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur la neurobiologie du stress et de la résilience. Ces recherches sont menées en étroite collaboration avec d’autres chercheurs et cliniciens, notamment de l’Université Laval.
De précieux détours
Caroline Ménard possède une feuille de route atypique. Après un postdoctorat en biophysique, réalisé sous la direction du scientifique en chef du Québec Rémi Quirion entre 2009 et 2012, elle fait un court séjour dans l’industrie avant de renouer avec ses premières amours en 2014 à l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, à New York. C’est là-bas que la scientifique acquiert son expertise actuelle − auparavant, elle étudiait les processus d’apprentissage et de mémoire. « Tout le monde est touché de près ou de loin par le stress et la dépression. Ce sont des sujets qui ont une portée universelle », pense-t-elle.
Paradoxalement, ce sont ces détours qui lui ont permis de mettre au point un programme de recherche assez unique en son genre. « À New York, je participais à ce qu’on appelle le depression club, un rendez-vous où les psychiatres et les chercheurs échangent sur leurs champs d’intérêt communs. On tend à séparer la recherche clinique de la recherche fondamentale, mais c’est une grave erreur. Pour avoir une perspective globale sur une problématique donnée, il faut plutôt briser les silos », conclut Caroline Ménard.
Yves De Koninck, qui a aidé, à titre de directeur scientifique du Centre de recherche CERVO, à recruter Caroline Ménard, abonde dans le même sens. « Les parcours atypiques comme ceux de Caroline représentent l’avenir. Il faut ça pour ultimement favoriser l’innovation, l’inclusivité et la représentativité en recherche, dit le professeur de psychiatrie et neurosciences de l’Université Laval. Des parcours comme le sien sont la preuve qu’un changement de culture s’opère dans le milieu. C’est perçu de moins en moins négativement. »

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
RQ : En quoi votre feuille de route atypique a-t-elle contribué à façonner la chercheuse que vous êtes devenue ?
CM : Je crois que cela m’a poussée vers une recherche plus multidisciplinaire. J’ai longuement réfléchi à la meilleure façon d’intégrer les connaissances acquises en biophysique, en biologie cellulaire et moléculaire, en comportement animal, en neurobiologie et en immunologie dans mon programme de recherche. Puisque j’ai participé à des projets de recherche variés, j’ai maintenant un large réseau de collaborateurs et cela favorise l’avènement d’une science innovante. La santé humaine est un tout et un seul domaine de recherche ne peut suffire à la comprendre. Enfin, mon expérience dans l’industrie et les diverses expériences de vulgarisation scientifique avec le public intéressent beaucoup mes étudiants, qui ont de la sorte une vision plus large des possibilités d’emploi après leurs études en science.
RQ : Briser les silos en recherche veut aussi dire collaborer avec d’autres disciplines. Lesquelles vous ouvrent le plus de perspectives pour vos travaux ?
CM: Je trouve très important d’intégrer un volet clinique à nos projets, lorsque c’est possible, afin de valider nos données obtenues chez la souris. Cela peut se faire grâce à des collaborations avec des cliniciens et à des ressources telles que la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada ou la biobanque Signature. Il s’agit d’un défi : parfois le langage, les attentes et les limites diffèrent entre les sciences cliniques et les sciences fondamentales et il faut donc s’adapter. J’adore aussi participer au transfert des connaissances vers les professionnels de la santé. D’un point de vue plus technique, j’ai choisi de revenir au Canada et de m’installer au Centre de recherche CERVO, affilié à l’Université Laval, compte tenu de la transdisciplinarité et de la collégialité qui y règnent. J’ai des collègues spécialisés en neurosciences et en psychiatrie, mais également en physique, en génie et en mathématiques. Cela permet d’élaborer des techniques de microscopie et d’imagerie de pointe ainsi que de mettre à profit l’intelligence artificielle pour mieux comprendre la biologie sous-jacente à la réponse au stress et à la dépression. Mes collègues américains et européens sont jaloux !
RQ : Sur une note plus personnelle, durant votre stage postdoctoral sous ma direction, qu’avez-vous appris de plus important ?
CM : Que la science se fait en équipe et qu’il faut voir grand ! C’était ma première expérience dans une équipe de plus d’une vingtaine de personnes, dont des étudiants et des postdoctorants de partout dans le monde, et cela constituait une grande force. La diversité d’opinions et d’expertises permet de pousser la recherche plus loin et de sortir des sentiers battus. J’ai aussi eu une grande liberté pour mener mes projets, ce qui m’a permis de développer mon autonomie et mon esprit critique. Cela m’a également forcée à être plus créative dans mes hypothèses, même si se lancer dans le vide avec une idée pour laquelle il y a peu de littérature scientifique est terrifiant ! J’essaie avec ma propre équipe de reproduire ce schéma et je pousse mes étudiants à explorer et à repousser leurs limites.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.