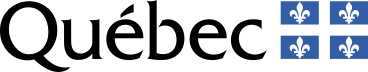Marie-Laurence Lemay s’emploie à bonifier nos connaissances sur les phages, des virus qui s’en prennent aux bactéries, les bonnes comme les mauvaises.
Blanc, jaune ou orangé, peu importe : les Canadiens fondent pour le cheddar ! Bon an, mal an, ils engloutissent en moyenne plus de trois kilos de ce fromage à pâte dure originaire d’Angleterre. Comme plusieurs autres produits laitiers fermentés, le cheddar n’existerait toutefois pas sans le précieux coup de pouce de Lactococcus lactis. C’est grâce à cette bactérie que le lait coagule et se transforme en caillé, première étape nécessaire à l’obtention d’un délice fromagé à insérer préférablement entre deux tranches de pain grillées. Bien entendu, l’industrie laitière prend toutes les précautions possibles afin de faciliter la vie de Lactococcus lactis.
Malgré tout, des invités-surprises viennent parfois importuner cette artisane du cheddar. Leur nom : les phages virulents de lactocoques appartenant au groupe sk1. Autrement dit, des virus qui s’attaquent aux bactéries. Un en particulier a retenu l’attention de Marie-Laurence Lemay lors de son doctorat en microbiologie réalisé à l’Université Laval : p2. « Il se trouve que c’est aussi un phage modèle sur lequel on disposait préalablement de beaucoup d’informations », se souvient celle qui est aujourd’hui chercheuse postdoctorale au sein du laboratoire d’Yves Brun, rattaché au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal.
Dans ce projet de recherche, elle a exploité l’outil CRISPR-Cas9 afin d’étudier les gènes de p2 qui « ordonnent » la fabrication des protéines impliquées dans l’infection de Lactococcus lactis. « On était alors en 2014, on commençait à peine à parler de ce fameux outil d’édition génétique. Ma mission était de transférer ce système d’une bactérie à une autre qui ne le possédait pas dans l’espoir de rendre p2 inopérant », raconte celle qui a obtenu, à la fin 2021, une bourse d’excellence en recherche dans le cadre du programme L’Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science. Ce prix soutient de jeunes scientifiques canadiennes sélectionnées par un comité d’experts à un moment charnière de leur carrière.
Il aura finalement fallu une année et demie avant que Marie-Laurence Lemay réalise ce tour de force. « Cela n’avait jamais été fait auparavant. Une chance que j’ai une tête de cochon, parce que l’incertitude quant à la faisabilité de ce transfert était grande », indique-t-elle. Dans la foulée, elle a rédigé un protocole long d’une vingtaine de pages, publié en 2018 dans Bio-protocol, une revue savante accessible gratuitement. Cela est primordial, explique la principale intéressée. « À quoi sert de développer un tel outil si personne n’est en mesure de l’utiliser ? Encore aujourd’hui, c’est un de mes articles qui me rendent le plus fière. »
Marie-Laurence Lemay s’intéresse ces temps-ci aux « bons » phages, qui peuvent être une solution de rechange aux antibiotiques. Ces médicaments sont utilisés pour prévenir et traiter les infections bactériennes. Les bactéries ont cependant la fâcheuse tendance à évoluer au fil du temps, ce qui les amène à développer une résistance à ces molécules. Les conséquences sont nombreuses : augmentation des dépenses médicales, prolongation des hospitalisations, voire hausse de la mortalité. L’Organisation mondiale de la santé considère d’ailleurs la résistance aux antibiotiques comme un problème de santé publique comparable en dangerosité à celui d’une pandémie.
Les phages pourraient donc être utilisés en renfort, parce qu’ils sont capables de tuer des bactéries nocives pour la santé. Encore faut-il comprendre comment ils ciblent, infectent et tuent les bactéries, ce à quoi s’évertue la chercheuse. « Je m’intéresse cette fois-ci à un autre phage nommé phi CbK, qui infecte la bactérie Caulobacter crescentus [qui ne touche pas les humains] et a la particularité de posséder un gros bagage génétique, ce qui en fait un modèle intéressant. Pour ce faire, je recours à des outils comme la microscopie à fluorescence », spécifie Marie-Laurence Lemay. À terme, les résultats de ces travaux pourront être transposés à des bactéries à l’origine d’infections chez l’humain, comme Staphylococcus aureus et Escherichia coli.
Elle a en tout cas ce qu’il faut pour s’acquitter de cette autre mission complexe, y compris une expérience d’une année à titre de responsable du Laboratoire de recherche et développement chez Agropur. C’est d’ailleurs cette parenthèse industrielle qui a confirmé son désir d’embrasser pour de bon une carrière universitaire. « Marie-Laurence est une meneuse née, estime Sylvain Moineau, professeur au Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique de l’Université Laval, qui l’a dirigée au troisième cycle. La Faculté de médecine dentaire est même allée jusqu’à créer un Prix de leadership pour le lui remettre ! » Une anecdote qui vaut la peine d’en faire tout un fromage.

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
RQ : Quel parcours ! Qui a été votre mentor pendant votre cheminement dans l’univers de la recherche ?
J’en ai eu plusieurs, mais, si je dois n’en nommer qu’un, ce sera Sylvain Moineau, qui a sans aucun doute été l’un des plus importants pendant mon cheminement. J’ai fait ma maîtrise et mon doctorat dans son laboratoire. Sylvain est officier de l’Ordre du Canada, en plus d’être l’un des chercheurs les plus influents au monde dans le domaine des phages. Malgré tous les honneurs qu’il a reçus, il reste simple, modeste, à l’écoute. C’est un leader modèle. Il m’a accordé la liberté et la confiance dont j’avais besoin pour m’accomplir en tant que jeune scientifique.
RQ : Dans quels autres secteurs industriels les phages pourraient-ils être mis à contribution ?
Dans tous les secteurs où il y a des bactéries. Ils recèlent en effet un potentiel économique et environnemental important pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, biotechnologiques et des ressources naturelles.
RQ : De votre point de vue, quelles sont les différences entre l’univers universitaire et celui de la recherche dans le secteur privé ?
D’après mon expérience, il y a plus de place pour la recherche fondamentale dans le monde universitaire, alors que, dans le secteur privé, la recherche appliquée est priorisée. Une autre différence importante réside dans le fait que les occasions d’emploi sont beaucoup plus nombreuses dans le secteur privé. Cela dit, que ce soit dans les universités ou dans les industries, les scientifiques ont tous les mêmes objectifs, soit apprendre et créer de nouvelles connaissances.
RQ : Quel est l’impact économique de ces recherches pour le secteur de la santé ?
Il est énorme pour le secteur de la santé, quoique difficilement évaluable. Par exemple, l’industrie des biotechnologies, qui se chiffre à des milliards de dollars, n’aurait pas vu le jour sans l’étude des interactions phages-bactéries. La découverte des systèmes de restriction-modification dans les années 1950, la purification des enzymes de restriction près de deux décennies plus tard ainsi que la caractérisation des systèmes CRISPR-Cas dans les années 2000 ont été possibles grâce à l’étude de la réponse bactérienne à l’infection aux phages. Aujourd’hui, ces technologies sont indispensables en recherche et pour certaines applications en santé.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.