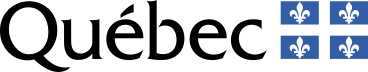Marie-Soleil L’Allier consacre sa thèse de doctorat aux « communs » urbains, un régime de partage qui a le vent en poupe à l’heure des défis environnementaux.
La ville de Gand, en Belgique, mérite sans peine le titre de capitale mondiale de la mise en commun ou commoning. En 2017, on y trouvait près de 500 projets de « communs » urbains, comme des jardins communautaires, des bibliothèques d’outils et des ateliers de fabrication collaboratifs. C’est 10 fois plus qu’il y a une décennie, peut-on lire dans un rapport commandé par la ville de 300 000 habitants. De fait, la mise en commun de la gestion de ressources par des groupes de résidants y est si avancée qu’il est possible de satisfaire n’importe quel besoin grâce à elle, souligne Marie-Soleil L’Allier, étudiante au doctorat en sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Du prêt de perceuses aux coopératives d’habitation en passant par la gestion de bâtiments publics et la mobilité partagée, la notion de propriété y est revue et corrigée. « À Gand, les communs représentent une troisième voie à l’État et au marché privé », résume celle qui était à Barcelone, une autre ville très portée sur le commoning, lorsque Québec Science l’a interviewée.
Si Marie-Soleil L’Allier parcourt ainsi le monde, c’est parce qu’elle étudie l’apport des projets fondés sur les communs à la transition écologique, cette idée selon laquelle une refonte du modèle économique et social est nécessaire pour faire face aux enjeux climatiques. Son objectif : faire avancer les connaissances sur un sujet qui a été très peu exploré jusqu’à maintenant dans la littérature scientifique. « Je souhaite tout d’abord dresser un bilan comparatif d’initiatives québécoises et européennes, comme celles de Gand. Puis je sélectionnerai une dizaine de cas de communs urbains d’ici comme d’ailleurs afin de les étudier plus en profondeur », explique celle qui peut compter sur l’une des 15 bourses accordées annuellement à des doctorants en sciences humaines et sociales par la Fondation Pierre Elliott Trudeau.
La tête de l’emploi
Marie-Soleil L’Allier ne se destinait pourtant pas à une carrière universitaire. Titulaire d’un baccalauréat en informatique et génie logiciel, elle a travaillé pendant une dizaine d’années dans ce domaine avant de frapper un mur. « J’ai souffert d’épuisement professionnel, laisse-t-elle tomber. Cet arrêt forcé m’a permis de réfléchir au sens que je donne au travail et de constater qu’il n’était pas en adéquation avec mes valeurs. » Écologiste convaincue, elle décide de tout lâcher pour effectuer un retour aux études à la maîtrise en sciences de l’environnement à l’UQAM à l’âge de 36 ans. Rapidement, la question des entreprises qui prennent le virage écologique la fascine. « À l’époque, il était beaucoup question d’entreprises qui contribuent, par leurs actions, à migrer vers une économie verte. J’ai décidé de mettre à l’épreuve ce discours », raconte-t-elle.
Première étape : brosser un portrait de l’entreprise type engagée dans la transition écologique. À l’issue de cet exercice, elle dégage plusieurs grands critères qui permettent de définir cette « nouvelle » génération d’entreprises. Parmi eux, une compréhension de la gravité de la crise environnementale, une volonté d’atteinte d’équité et de justice sociale, de même qu’une adhésion à une redéfinition profonde de la notion de croissance. Armée de ce filtre d’analyse, Marie-Soleil L’Allier a ensuite réalisé un sondage auprès de 38 PME de l’économie verte du Québec. Le but : les situer sur un continuum allant de celles implantées au cœur des régimes sociotechniques dominants (comme l’utilisation de l’automobile traditionnelle comme moyen de transport le plus répandu) jusqu’à celles répondant à la définition de l’entreprise de la transition écologique, peut-on lire dans son mémoire de maîtrise. « Au final, 14 répondaient assez bien à l’idéal type, même si aucune entreprise n’était parfaite », rapporte-t-elle.
À quelques mois de la fin de ses études de deuxième cycle, en 2014, Marie-Soleil L’Allier savait déjà que sa place était au doctorat et non dans l’unité de développement durable d’une grande entreprise. Pourtant, c’est la casquette d’entrepreneure qu’elle finit par porter, à titre de cofondatrice de la chaîne de magasins d’alimentation zéro déchet LOCO, la première du genre au Québec. « Un soir autour d’un verre, trois copines et moi, toutes étudiantes aux cycles supérieurs, avons lancé l’idée folle de révolutionner la façon dont les Québécois font leur épicerie. Le lendemain, on se lançait vraiment dans ce projet », se souvient-elle. Après moult péripéties, un premier LOCO ouvrait ses portes deux ans plus tard sur la rue Jarry Est, à Montréal. Depuis, deux autres adresses à Verdun et à Brossard ont vu le jour. Pour la doctorante, cela a été l’occasion de mettre en pratique des concepts théoriques. Mais surtout de s’engager. « C’est la seule manière de combattre le cynisme. Le zéro déchet, à mes yeux, est un chemin vers une nouvelle mentalité au potentiel transformateur. »
Un sujet trop important
Dans sa thèse, Marie-Soleil L’Allier compte relater la vaste histoire du concept des communs − il remonte à la Rome antique (res communes), puis a été bouleversé tour à tour par l’arrivée du capitalisme moderne et par l’avènement du numérique. En outre, elle souhaite mettre le doigt sur les conditions gagnantes qui expliquent le succès de certains de ces projets à Gand et à Barcelone. Pour ce faire, la scientifique analysera notamment leur relation avec les municipalités de même que le soutien offert par ces dernières, indique Jonathan Durand-Folco, professeur à l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, et codirecteur de la thèse de l’étudiante. « Les travaux de Marie-Soleil permettront de repenser autrement la transition écologique, fait-il remarquer. C’est un sujet de la plus grande importance et, cela, la Fondation Pierre Elliott Trudeau l’a bien compris. »

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
RQ : Quels sont les défis et les gains d’un retour aux études à 36 ans, après 10 ans sur le marché du travail ?
MSL : Le principal défi a été le changement de mode de vie ! Revenir à un revenu d’étudiant a demandé quelques ajustements. J’ai alors eu l’occasion de découvrir la démarche zéro déchet et de me (re)définir autrement que par ma consommation !
Un retour aux études est souvent précédé d’une période d’introspection. Qu’est-ce que j’ai envie de faire ? Quelles sont mes forces ? Comment puis-je les utiliser pour contribuer au bien commun ? Par conséquent, le choix de la discipline est davantage en harmonie avec qui l’on est et qui l’on veut devenir.
RQ : À titre de chercheuse-entrepreneure, quels leviers ont été favorables dans la création de l’épicerie zéro déchet LOCO ?
MSL : En fait, les rythmes de la recherche et de l’entrepreneuriat sont extrêmement difficiles à conjuguer ! Alors que le premier exige du temps pour la réflexion, le second nécessite plutôt de la rapidité et de la réactivité, en plus d’envahir tout l’espace mental ! Le principal levier a donc été d’avoir une équipe de fondatrices chercheuses-entrepreneures. Certaines se sont spécialisées dans les opérations et la gestion des épiceries, et d’autres dans des activités de recherche. De plus, nous avons bénéficié d’un très bon accompagnement du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM.
Il faut aussi préciser que LOCO est un incroyable laboratoire d’expérimentation. Nous pouvons à la fois y tester et mettre en pratique des théories et connaissances scientifiques, et prendre du recul afin de favoriser les apprentissages.
RQ : À la tête des entreprises engagées dans la transition écologique, il y a des entrepreneurs tout aussi convaincus. Quelles sont les principales qualités de ces gestionnaires ?
MSL : D’abord, une compréhension profonde des crises écologiques et climatiques que nous rencontrons. Ce point est primordial, car il détermine le type de solution élaborée par l’entrepreneur. Nous ne sommes plus à l’époque où il fallait simplement polluer moins, recycler et faire attention. Aujourd’hui, il faut passer d’une économie qui détruit la nature à une économie qui protège la nature et en prend soin. Si l’on ne comprend pas cela, il est impossible d’imaginer des solutions qui règleront les problèmes à la source.
Ensuite, il faut être extrêmement motivé et persévérant. L’entrepreneur de la transition s’engage à changer un système sur lequel il n’exerce pas d’influence, mais son succès se mesure à sa capacité de le rendre plus soutenable. Pour y parvenir, l’entrepreneur doit effectuer un travail colossal des points de vue tant cognitif, institutionnel et économique que politique.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.