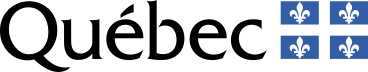Dominique Claveau-Mallet a travaillé sur une technologie capable de venir à bout du phosphore responsable de la prolifération des algues bleu-vert dans les lacs du Québec.
Le lac Brome, le lac Beauport, le lac Saint-Augustin : la liste des étendues d’eau qui se meurent dans le sud de la province est longue. Le responsable de cette hécatombe silencieuse n’a pourtant rien d’un meurtrier. Son nom : le phosphore, un sel minéral essentiel à la vie, mais qui a tendance à se retrouver en trop grande quantité dans les cours d’eau préférés des villégiateurs. Au-delà d’une certaine concentration de cet oligoélément, l’eau devient bleu-vert et visqueuse, comme une soupe épaisse. En cause, la prolifération de cyanobactéries. Ces microorganismes libèrent des toxines dangereuses avec lesquelles le Québec a fait connaissance en 2006 et en 2007, lors d’épisodes aigus d’algues bleu-vert, comme on appelle ces bactéries.
Plus de 10 ans après, la « crise » sévit toujours, affirme Dominique Claveau-Mallet, stagiaire postdoctorale à l’Université McGill. « Ce n’est pas parce que nous n’entendons plus parler de la problématique qu’elle n’existe plus. Sa gravité fluctue selon les années et les conditions météorologiques », explique la chercheuse et mère de deux enfants − bientôt trois. Une chose est sûre, cependant : ces éclosions sont « nourries » par un apport régulier en phosphore, corollaire des rejets d’eaux usées domestiques (toilette, douche…) en provenance des chalets qui bordent les lacs et de leurs installations septiques rarement aux normes.
Dans une usine de filtration d’eau, le retrait du phosphore des eaux usées domestiques se fait de manière chimique ou par un procédé de membranes. Ces technologies complexes exigent cependant l’intervention d’une main-d’œuvre spécialisée, ce qui est impossible avec des installations septiques enfouies sous terre et vidangées tous les deux à quatre ans. Résultat : de 2 mg à 8 mg de phosphore par litre d’eaux usées filtré sont rejetés par les chalets en moyenne, ce qui dépasse largement la norme environnementale de 1 mg fixée par le gouvernement du Québec… Ce dernier ferme les yeux sur la situation étant donné le cul-de-sac technologique.
Du moins jusqu’à tout récemment. « Dans mon doctorat, j’ai travaillé sur une technologie à base de filtre à scories, qui sont un sous-produit de l’extraction du fer qui retient le phosphore dans les eaux usées. Grâce à ce dispositif, nous atteignons sans problème des valeurs de 0,5 mg de phosphore par litre d’eaux usées filtré », fait valoir celle qui a reçu une Médaille académique du Gouverneur général du Canada en juin dernier au terme de ses études doctorales à Polytechnique Montréal. Cette reconnaissance, l’une des plus prestigieuses au pays, souligne l’obtention de la meilleure moyenne universitaire.
Une première technologique
La magie opère après que les eaux usées ont franchi les deux premières étapes de traitement, soit la fosse septique (décantation) et le champ d’épuration (dégradation par voie biologique), qui filtre les déchets organiques. Les eaux usées pénètrent alors dans le filtre à scories, lesquels contiennent de la chaux qui réagit avec le phosphore dissous. Une réaction de précipitation se déroule alors ; des cristaux granuleux d’hydroxyapatite se collent aux scories, piégeant de facto le phosphore.
À un certain moment, le filtre est saturé de cristaux. Quand ? Dominique Claveau-Mallet a bâti un outil mathématique, P-Hydroslag, pour le déterminer. « À partir de diverses variables, comme la nature de l’affluent et le type de champ d’épuration, j’ai réalisé des simulations informatiques qui permettent de prédire la vie utile effective d’un filtre à scories. Le but était de garantir une efficacité de plusieurs années », dit-elle.
Ces travaux ont été menés en partenariat avec Bionest, une compagnie spécialisée en traitement des eaux usées produites par des résidences isolées, comme les chalets. Cette collaboration avec l’industrie a permis de mettre à l’épreuve ces prédictions sur le terrain. En outre, elle a abouti au dépôt d’un brevet commun relatif à cette technologie passive de déphosphoration.
Serge Baillargeon est directeur de la recherche et du développement chez Bionest. C’est avec lui que Dominique Claveau-Mallet a collaboré pendant ses cinq années de doctorat. La technologie qu’ils ont mise au point est en cours de certification. Si tout va bien, elle devrait être commercialisée « quelque part en 2019 », pense-t-il. Bionest comblera alors un vide dans un marché au potentiel énorme − il y aurait environ un million d’installations septiques au Québec. « Pour la première fois, nous pourrons garantir l’enlèvement du phosphore des eaux usées pendant une période de 8 à 15 ans », prévoit-il.
L’employé de Bionest ne tarit pas d’éloges à l’endroit de sa partenaire de recherche. « Elle est une collaboratrice hors pair, une des meilleures chercheuses qui nous a été donné de côtoyer », jure-t-il. Brillante, prompte et professionnelle, Dominique Claveau-Mallet a épargné à Bionest plusieurs années d’essais et de tâtonnements infructueux, estime Yves Comeau, professeur à Polytechnique Montréal et directeur de thèse de l’étudiante. « Dominique a cette capacité extraordinaire de devenir experte en tout. Travailler avec elle est extrêmement agréable », conclut-il.

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
R.Q. : Pour vous, était-ce un préalable que vos recherches aient un impact environnemental ?
D.C.-M. : Quand j’ai décidé d’entreprendre des études supérieures, j’étais très intéressée par les marais artificiels. Ça me passionnait de voir qu’on peut imiter des procédés naturels pour ramener les eaux usées à la nature de la manière la plus simple possible. Ce qui est important pour moi, c’est l’utilisation intelligente des ressources, et l’eau est certainement une ressource primordiale. Mes travaux contribuent à éviter une forme de pollution qui autrement serait inéluctable.
R.Q. : Aviez-vous imaginé que vos recherches seraient appliquées si rapidement ?
D.C.-M. : Au début non ! Le défi était grand parce que les filtres à scories étaient trop mal compris pour être utilisés facilement. De plus, une grande partie de mon travail était assez abstraite – j’ai beaucoup réfléchi à la géochimie et à la précipitation de minéraux de phosphore ! Ce fut une étape marquante lorsque j’ai compris le potentiel de mes premiers résultats de modélisation. Ça s’est accéléré lorsque mon équipe s’est associée à Bionest. Il s’est créé une belle synergie entre l’université et l’industrie : j’avais une connaissance plus fondamentale du procédé et Bionest avait les ressources et l’expérience pour la mise en œuvre de nouvelles technologies.
R.Q. : Comment avez-vous réussi à concilier le travail et la famille ?
D.C.-M. : C’est vrai que, dans le domaine de la recherche, on revient nécessairement à la maison avec les projets dans la tête, en quête d’idées géniales. Malgré tout, je n’ai jamais travaillé le soir ou la fin de semaine, ou très rarement. Mon secret, c’était d’organiser mon temps et mes projets le plus efficacement possible et de formuler des objectifs clairs. Dormir et me reposer faisaient aussi partie de l’horaire… Quand on divise les projets en tâches simples, tout devient plus facile. Suivant ce principe, j’ai écrit la majorité de ma thèse dans le train par blocs de 45 minutes.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.