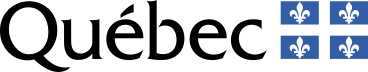En 2023, les 55 ans et plus occupaient plus de 22 % des emplois, soit près d’un million de postes (Institut de la statistique du Québec, 2024). Dans ce contexte, soutenir l’engagement et le bien-être des travailleur.euse.s expérimenté.e.s ne relève plus d’un simple choix organisationnel, mais d’un enjeu stratégique majeur. Or, cette population est loin d’être homogène dans ses attentes et ses besoins.
Cette recherche met en évidence trois profils de besoins chez les travailleur.euse.s de 45 ans et plus. Le premier, “ Se réaliser et transmettre ”, regroupe des personnes motivées par le désir de contribuer socialement, de partager leurs savoirs et de laisser une trace significative. Le deuxième, “ Préserver son autonomie et contribuer ”, est associé à des individus qui privilégient la santé, la stabilité financière et le soutien aux proches. Enfin, le profil “ Ralentir et profiter de la vie ” exprime un besoin de modérer le rythme professionnel, de se recentrer sur soi et de rechercher un meilleur équilibre entre les sphères de vie. Ces profils ne sont pas déterminés par l’âge, mais plutôt par le parcours de vie professionnelle, qu’il soit stable, fluctuant, en dents de scie ou erratique.
Ce résultat remet en question le recours à l’âge comme principal repère dans les politiques de gestion et de maintien en emploi. Ce ne sont pas les années, mais les parcours et les besoins actuels qui doivent guider l’action. Les approches fondées sur l’âge ou l’ancienneté, en supposant des besoins homogènes, risquent de ne convenir qu’à un seul type de profil. Ces résultats appellent à une gestion différenciée, centrée sur la pluralité des parcours. Il s’agit d’identifier les profils à l’aide d’outils simples, puis d’ajuster les leviers d’action : mentorat ou projets à impact social pour certains, assouplissements d’horaires ou stabilité financière pour d’autres, ou encore marges de manoeuvre accrues pour ralentir et se recentrer.
Les retombées sont stratégiques : meilleure santé psychologique, satisfaction professionnelle accrue, réduction du roulement et fidélisation des expertises clés. En contexte de rareté, c’est un levier fort d’optimisation des ressources humaines. Miser sur une compréhension fine des parcours et besoins des travailleur.euse.s expérimenté.e.s, c’est investir dans des milieux de travail durables, agiles et inclusifs.
Chercheure principale
- Lise Lachance, Université du Québec à Montréal
Cochercheuses et cochercheurs
- Louis Cournoyer, Université du Québec à Montréal
- Louis Richer, Université du Québec à Chicoutimi
- Geneviève Fournier, Université Laval
Dépôt du rapport de recherche : juin 2025