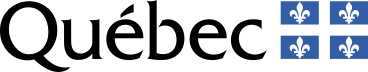Au diable les vases clos ! Noémie-Manuelle Dorval Courchesne puise des savoirs dans plusieurs disciplines connexes afin de fabriquer les matériaux de demain.
Bientôt à vendre : un legging de yoga capable à la fois de se réparer par lui-même si vous exagérez les postures du guerrier, d’émettre de la lumière selon votre état de santé et de se dégrader dans la nature lorsque vous vous en débarrasserez. Trop beau pour être vrai ? La professeure du Département de génie chimique de l’Université McGill Noémie-Manuelle Dorval Courchesne s’emploie pourtant à faire de ce scénario de science-fiction une réalité. Son but : concevoir des matériaux… vivants !
« La plupart des matériaux que nous produisons sont dérivés de bactéries, tout particulièrement d’une version inoffensive d’E. coli. Elles produisent des protéines qui ont entre autres la capacité de s’autoassembler », explique la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux d’origine biologique. Une fois ces protéines modifiées génétiquement – en étant rendues photosensibles, par exemple –, elles forment un biofilm, c’est-à-dire un gel fonctionnel à appliquer à la surface de tissus. Ces travaux se situent à l’intersection de la science des matériaux, du génie chimique, de la biologie synthétique et de la nanotechnologie.
« J’aime beaucoup l’aspect créatif de la multidisciplinarité », affirme la lauréate d’un Johnson & Johnson WiSTEM2D Scholars Award en 2022. Ces prix prestigieux – les candidatures se comptent par centaines – sont remis à six chercheuses de renommée mondiale en science, technologie, génie, mathématiques, fabrication et conception.
DANS SON COFFRE À OUTILS
Pour réaliser ses bricolages de haute voltige, Noémie-Manuelle Dorval Courchesne recourt à toutes sortes de méthodes de génie génétique. Parmi elles, il y a le clonage par assemblage de brins Gibson, du nom de son créateur, Daniel G. Gibson, cofondateur d’une société californienne de biologie synthétique. « Cela consiste à couper un plasmide [une unité d’ADN indépendante] à certains endroits pour y substituer un morceau de gène qui coderait pour une protéine d’intérêt », c’est-à-dire un morceau détenant le message génétique correspondant à cette protéine, explique la chercheuse.
L’évolution dirigée, soit l’introduction de mutations génétiques au hasard de manière à obtenir une grande diversité de protéines, fait aussi partie de son coffre à outils. Le but : retenir les protéines qui présentent des séquences d’acides aminés – donc des propriétés fonctionnelles – jugées intéressantes.
« Nous parvenons ainsi à améliorer l’affinité d’une protéine avec une surface. Après plusieurs cycles d’évolution dirigée, nous sommes littéralement en présence d’une protéine unique en son genre », indique-t-elle. Ces recherches de pointe attirent l’attention du secteur privé. Au fil des années, Noémie-Manuelle Dorval Courchesne a noué des partenariats industriels, y compris avec la compagnie de vêtements sportifs Lululemon. C’est pourtant sur le front de l’environnement que ces biomatériaux pourraient avoir la plus grande importance. « La conception de matériaux dérivés de la biologie a le potentiel de régler des problèmes de durabilité au début et à la fin du cycle de vie de nombreux produits », croit la professeure.
POUR LES BONNES RAISONS
Il reste cependant bien du chemin à parcourir avant d’en arriver là. Dans les mois et années à venir, Noémie-Manuelle Dorval Courchesne compte par exemple intensifier ses travaux sur l’évolution dirigée, mais cette fois-ci pour des applications électroniques. C’est d’ailleurs le financement de Johnson & Johnson – 150 000 dollars américains (environ 200 000 dollars canadiens) et trois ans de mentorat – qui lui permet de creuser cet axe de recherche. « Nos résultats sont prometteurs », révèle la principale intéressée. Si le passé est garant de l’avenir, elle est appelée à poursuivre sa trajectoire d’excellence, estime Viviane Yargeau, doyenne de la Faculté de génie de l’Université McGill. « À moyen et long terme, Noémie fera certainement changer les choses, tant en recherche ou en enseignement que pour la société », prédit celle qui dirigeait auparavant le Département de génie chimique de l’Université. « Elle est là pour les bonnes raisons, pas pour sa petite gloire personnelle. »

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
Votre profil de chercheuse est très interdisciplinaire. Y a-t-il une autre discipline avec laquelle vous souhaiteriez collaborer? Et quels défis supposent ces collaborations entre experts d’horizons variés?
Oui, je collabore déjà avec des gens de plusieurs disciplines, dont la physique, la biochimie, le génie mécanique et le génie biomédical. Je souhaiterais sortir un peu du domaine des sciences et du génie et collaborer avec plus de gens en sciences sociales, des gens qui ont une perspective sur les impacts environnementaux des matériaux et qui pourraient contribuer à vérifier l’acceptation sociale des technologies que nous développons. Trouver un langage commun peut être un défi au début de toute collaboration, mais, ensuite, de riches discussions sont possibles. Lorsque les perspectives sont très
différentes, les défis sont plus grands, mais les gains le sont aussi!
Peut-on envisager, un jour, de recevoir un médicament par le vêtement que l’on porte? Ou peut-être cela existe-t-il déjà?
Ce type de technologies existe déjà, soit à l’aide de timbres à appliquer sur la peau ou bien de vêtements « intelligents » ! Par contre, plutôt qu’employer des matériaux « vivants » ou des protéines comme capteurs pour détecter des marqueurs de maladies, des technologies plus matures sont employées. Il existe par exemple des accessoires en tissus imprégnés de médicaments qui libèrent des molécules au cours d’une certaine période. Plusieurs groupes de recherche se concentrent aussi sur la livraison de médicaments, contrôlée ou déclenchée par un stimulus, des concepts qui peuvent être appliqués à ce besoin.
Est-ce que tout pourrait devenir biodégradable, grâce à l’évolution dirigée?
Quelle vision futuriste ! Je crois qu’il serait difficile de tout rendre biodégradable, d’abord car il n’est pas désirable que tout se dégrade – il faut prendre en considération la durée de vie désirée des matériaux dans différents domaines. Ensuite, pour les objets que nous aimerions en effet voir se dégrader, il faudrait déterminer si des protéines pourraient servir à leur fabrication et si l’évolution dirigée se prêterait bien à leur évolution. L’évolution dirigée est bien établie pour obtenir certaines propriétés, comme la fluorescence ou la catalyse par exemple, mais il demeure important d’avoir une méthode pour quantifier ces propriétés pour un grand nombre (des milliers ou plus !) de protéines avec des mutations aléatoires. Alors que nous tentons de surmonter ce défi et de diriger l’évolution de protéines conductrices dans mon laboratoire, je suis bien curieuse de voir jusqu’où cette méthode pourra être appliquée au génie des matériaux!
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.