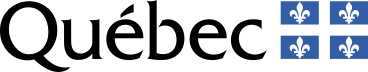Pier-Olivier Cusson
Candidat au doctorat en biologie, Université de Sherbrooke
Publication primée : Les phoques et la banquise : réponses comportementales contrastées face aux changements des conditions de glace du golfe du Saint-Laurent
Publiée dans : Le Climatoscope
Résumé :
Les banquises saisonnières sont de vastes étendues de glace temporaires qui se forment en hivers à la surface des océans dans les régions polaires et subpolaires. Elles jouent un rôle important dans la régulation du climat à l’échelle planétaire et fournissent un habitat essentiel à de nombreuses espèces animales. Au cours des dernières décennies, leur disparition graduelle est devenue un rappel constant des effets des changements climatiques.
Dans le golfe du Saint-Laurent, l’augmentation de la température de l’air mène au réchauffement des eaux de surface et au déclin de la banquise saisonnière. Ces changements ont des impacts importants sur cet écosystème qui est un point chaud de biodiversité et d’activités économiques au Québec. Traditionnellement, le phoque gris (Halichoerus grypus) et le phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus) utilisent la banquise dans le Golfe pour se reproduire. Elle fournit une plateforme solide et isolée sur laquelle les femelles peuvent mettre bas et prodiguer leurs soins maternels à l’abri des prédateurs et à proximité des sources de nourriture. Les changements des conditions de glace des dernières décennies ont donc entraîné des conséquences importantes pour leur habitat de reproduction.
Face à cette nouvelle réalité, les deux espèces ont adopté des solutions comportementales contrastées. Les phoques gris ont graduellement opté pour l’abandon quasi complet de la glace comme lieu de mise bas au profit des plages d’îles du Golfe. Le résultat est une présence accrue de phoques gris dans le Golfe menant à une augmentation des conflits avec les activités humaines comme la pêche. Les phoques du Groenland, eux, sont demeurés fidèles à la banquise et continuent de l’utiliser comme site de mise bas. Le résultat est un déplacement progressif des sites de reproduction de cette espèce vers le nord et une réduction des naissances dans le golfe du Saint-Laurent. Le contraste entre ces deux stratégies mène, petit à petit, à un isolement spatial entre ces deux espèces qui cohabitaient traditionnellement.
Les deux populations demeurent abondantes, mais ces adaptations comportementales possèdent aussi leurs limites. Il est intéressant de se questionner si celles-ci seront efficaces à long terme et quelles en seront les implications écologiques. De plus, ces changements comportementaux entraînent aussi des conséquences pour les populations humaines du Golfe, notamment pour l’industrie touristique et la chasse traditionnelle.