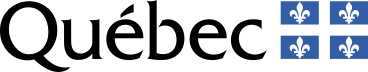Marie-Andrée Plante
Professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
Michaël Lessard
Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
Publication primée : Quand l’imprescriptibilité prend corps — la notion de préjudice corporel au regard des violences sexuelles, conjugales et infantiles
Publiée dans : Revue générale de droit
Résumé :
Cet article clarifie la notion de préjudice corporel en droit québécois et son application dans le cadre de recours judiciaires intentés par des victimes de violences sexuelles, conjugales et infantiles.
Depuis la modification de l’article 2926.1 du Code civil du Québec en 2020, les actions civiles relatives à des violences sexuelles, conjugales ou subies pendant l’enfance sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’elles peuvent être intentées sans aucune limitation de temps. Toutefois, cette imprescriptibilité ne s’applique qu’aux situations où le préjudice subi est considéré comme corporel, par opposition à un préjudice moral ou matériel.
Or, cette condition pose problème, car la définition de ce qui constitue un préjudice corporel revêt une certaine ambiguïté en droit québécois, ce qui entraîne des difficultés importantes pour les victimes cherchant à obtenir réparation.
Cet article analyse la littérature juridique et l’ensemble des jugements sur cette question afin de mieux cerner comment la notion de préjudice corporel s’articule. Il établit que la condition du préjudice corporel, telle qu’elle est actuellement interprétée, semble exiger qu’un seuil spécifique d’atteinte à l’intégrité physique soit franchi pour que l’on puisse parler de préjudice corporel. Autrement dit, afin qu’un préjudice soit qualifié de corporel et que les victimes puissent bénéficier de l’imprescriptibilité, le corps de la victime doit avoir subi une atteinte importante. Cela crée une distinction entre les victimes ayant subi des violences laissant des marques physiques et celles dont les blessures sont avant tout psychologiques.
En mobilisant des connaissances des champs du droit, de la sociologie et du travail social concernant le vécu des victimes, l’article souligne que, dans les cas de violences sexuelles, conjugales ou infantiles, les préjudices ne sont pas toujours strictement physiques. Par exemple, une agression sexuelle peut entraîner des traumatismes psychologiques graves sans nécessairement laisser de traces physiques visibles.
En outre, en s’appuyant sur une analyse du discours des débats parlementaires, l’article révèle que le critère de préjudice corporel est en décalage avec l’intention législative. La modification législative de 2020 visait en effet à améliorer l’accès à la justice pour toutes les victimes de violences, sans établir de hiérarchie entre elles. Pourtant, l’exigence de démontrer un préjudice corporel prive de nombreuses victimes, souffrant uniquement de séquelles psychologiques, d’obtenir réparation.
L’auteur et l’autrice font deux propositions dans l’article. En premier lieu, il et elle proposent une interprétation élargie du concept de préjudice corporel et soutiennent que tout préjudice découlant d’une agression sexuelle devrait être considéré comme un préjudice corporel, indépendamment de la présence ou non de blessures physiques visibles. Cette approche permettrait de mieux répondre aux besoins des victimes tout en concordant avec la pratique révélée au sein des jugements étudiés.
En deuxième lieu, il et elle suggèrent la simple élimination du critère du préjudice corporel de l’article 2926.1 du Code civil pour mieux répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles, conjugales ou subies pendant l’enfance. Ceci permettrait à toutes les victimes de bénéficier de l’imprescriptibilité, quel que soit le type de préjudice subi, rendant le système judiciaire plus accessible et équitable.