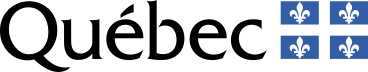Emna Fakhfakh
Étudiante au doctorat en sciences de l’orthophonie et de l’audiologie, Université de Montréal
Publication primée : Le théâtre comme voie vers l’inclusion
Publiée dans : DIRE
Résumé :
Saviez-vous qu’on peut perdre nos mots après un accident vasculaire cérébral? Cela s’appelle une aphasie, et l’aphasie vient créer des grosses difficultés de communication chez les personnes qui en sont touchées, près de 6000 nouvelles personnes et leurs proches par année au Québec!
Les orthophonistes sont les professionnel·les de la santé qui aident les personnes aphasiques à retrouver la meilleure communication possible. Mais, même avec une thérapie intensive, beaucoup de personnes aphasiques gardent des séquelles lorsque les services en orthophonie se terminent. La persistance des difficultés peut s’expliquer en partie par les défis auxquels sont confrontés les orthophonistes dans la réalisation des objectifs de réadaptation (manque de ressources et de temps alloués à chaque patient·e) ainsi que par les limites de récupération imposées par la lésion cérébrale elle-même.
Comme notre société est grandement basée sur la communication interpersonnelle, les personnes aphasiques se retrouvent souvent isolées socialement, ce qui influence négativement leur bien-être et ne favorise pas la récupération de leur communication. Cela peut même mener à des sentiments de dépression.
Les études scientifiques suggèrent que les milieux communautaires sont des espaces où les personnes aphasiques peuvent participer socialement tout en continuant à faire des progrès sur leur communication. Mais pour cela, il est important qu’ils adoptent des pratiques inclusives au regard des personnes avec un trouble de la communication.
Au Québec, le Théâtre Aphasique (TA), qui a été fondé en 1995 par une orthophoniste au sein de l’hôpital de réadaptation Villa Médica, a pour mission de favoriser la réadaptation et la réintégration sociale des personnes aphasiques par le biais d’ateliers de stimulation du langage et d’art dramatique. De par sa longévité, sa popularité au sein de la communauté aphasique et l’intérêt qu’il suscite à l’international, le TA apparaît comme un milieu communautaire exemplaire.
Mon projet de maîtrise portait sur l’étude des mécanismes du TA et de ses retombées. Les résultats nous informent que l’adoption de pratiques inclusives constituait l’une des clés de la réussite de cet organisme.
Contrairement à d’autres milieux qui n’implantent pas ces pratiques, l’approche du TA permet d’éliminer les obstacles rencontrés par les personnes aphasiques, telles que le sentiment d’exclusion et la peur d’être jugé. Elle permet aussi le développement des liens significatifs entre les membres grâce à la nature des activités proposées. De plus, les membres du TA apprécient beaucoup que l’organisme rassemble des personnes vivant la même situation, même si la sévérité du trouble peut varier.
Pour assurer la pleine participation des personnes aphasiques, les animateurs.rices du TA adaptent les activités selon les capacités de chacun.e. Cette adaptation est le fruit d’une longue collaboration avec une orthophoniste qui a permis aux intervenants.es d’acquérir des compétences dans l’adaptation des ateliers. En outre, les participants.es décrivent les animateurs.rices comme bienveillants et toujours prêts.es à les soutenir.
Pour conclure, le Théâtre Aphasique a contribué à d’importants changements dans la vie des personnes vivant avec des difficultés de communication. Plusieurs considèrent leurs pairs comme des membres de leur famille, et restent fidèles à cette communauté pour de longues années.