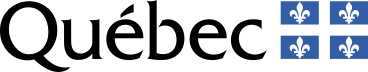Isabelle Bouchard
Professeure, Département des sciences humaines. Directrice des programmes de cycles supérieurs en histoire, Université du Québec à Trois-Rivières
Publication primée : La capacité juridique collective des Premières Nations avant la Loi sur les Indiens : l’exemple des Abénakis d’Odanak
Publiée dans : Revue d’histoire de l’Amérique française
Résumé :
Cet article porte sur les transformations de la capacité juridique des communautés autochtones au sein de l’ordre juridique colonial canadien entre la fin du 18e siècle et l’adoption des premières lois concernant les Premières Nations en 1850. Il montre comment la tendance grandissante au 19e siècle à envisager le statut corporatif comme découlant seulement de l’État a contribué à l’effacement de la capacité juridique des collectivités autochtones.
S’étant d’abord vu accorder une capacité juridique comme corps religieux (missions) dans les années 1830, les communautés autochtones ont ensuite été assimilées à des corps de nature politique. En effet, la création des corporations municipales dans les années 1840 influence la manière dont les juristes conceptualisent la capacité juridique des collectivités autochtones, soit leur capacité de posséder collectivement de biens et d’ester en justice. Les juristes considèrent désormais que la capacité juridique des groupes est un pouvoir qui relève uniquement de l’État par le biais d’une loi d’incorporation. Par conséquent, les collectivités autochtones sont désormais considérées comme étant dépourvues de personnalité juridique. Dans le contexte de cette transformation du droit, les Affaires indiennes se redéfinissent comme les gardiens légaux des Premières Nations à partir de 1850.
En définitive, la personnalité juridique apparaît comme un instrument juridique ayant facilité la dépossession des peuples autochtones. La démonstration s’appuie sur le cas de la communauté abénakise d’Odanak (Québec).