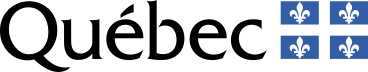Alex Alexis
Candidat au doctorat en droit
Université de Montréal
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Publication primée : Les controverses sur le séquençage numérique des ressources génétiques à la Convention sur la diversité biologique. Regards pragmatiques sur le droit international en train de se faire
Publiée dans : Cahiers Droit, Sciences & Technologies
Résumé
La biodiversité est riche en ressources génétiques qui sont utilisées pour développer des médicaments, fabriquer des parfums ou créer des variétés de plantes plus résistantes au changement climatique. Afin de lutter contre l’appropriation unilatérale de ces ressources (plantes, animaux, microbes) et des savoirs autochtones qui leur sont associés par les grandes firmes pharmaceutique, cosmétique et semencière, les États ont adopté la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cette convention impose l’accord préalable des États ou des communautés autochtones pour l’accès aux ressources génétiques, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. C’est le principe d’Accès et de Partage des Avantages, ou APA. Cependant, avec les innovations technologiques et scientifiques, notamment le développement du séquençage à haut débit et l’essor de la génomique, les ressources génétiques sont numérisées massivement et rendues accessibles librement, échappant ainsi de fait au principe APA. Cela a créé une controverse internationale qui agite depuis près de dix ans les parties prenantes de la CDB sur la question de savoir si ces ressources génétiques numérisées sont concernées par le principe APA.
En décembre 2022, lors de la COP15 à Montréal, une décision importante a été prise par les États parties à la CDB. Cette décision cherche à trouver une issue à cette controverse opposant les partisans du libre accès aux ressources génétiques numérisées (principalement des pays du Nord, des scientifiques et des entreprises) et ceux qui réclament leur inclusion explicite dans le champ du principe APA (pays du Sud, peuples autochtones, ONG environnementales). La décision tente de trouver un compromis entre ces revendications opposées, en optant pour un accès inconditionnel en amont aux ressources génétiques numérisées et un partage des avantages en aval en cas d’utilisation lucrative, le tout, dans le respect des droits des peuples autochtones. Mais composer avec des droits et des prétentions aussi divers n’est pas chose facile. La COP15 a d’ailleurs reconnu à juste titre qu’il restait encore beaucoup de questions à résoudre. À cet égard, la COP16, qui se tiendra en octobre 2024 à Cali, pourrait apporter de nouvelles surprises.
Après avoir rappelé l’origine, les termes et les enjeux de la controverse sur les ressources génétiques numérisées, l’article montre en quoi la décision de la COP15 constitue une étape importante dans la bataille autour du partage des données (génomiques) et, plus largement, dans la construction d’un droit international émergeant de la science ouverte. Quoiqu’il traite spécifiquement des tensions liées à la régulation de la biodiversité et des biotechnologies, l’article intéressera sans doute toute personne préoccupée par les enjeux de justice et d’équité au cœur de nos sociétés numériques.