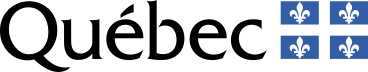Les arbres en ville rendent de précieux services, mais ils peuvent aussi constituer une nuisance pour une partie de la population aux prises avec des allergies ou des problèmes de santé respiratoire. Le principal responsable : le pollen. Actuellement, il est difficile de comprendre quelles sont les espèces d’arbres les plus problématiques puisqu’on ne possède pas un portrait juste de la forêt urbaine. Des experts de la santé publique ont voulu remédier à la situation en travaillant main dans la main avec des écologistes.
Cette union improbable mais fructueuse a été rendue possible par une subvention du programme AUDACE. L’équipe d’Audrey Smargiassi, professeure au Département de santé environnementale et santé au travail à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, s’est aussi entourée de chercheurs en foresterie sociale, en sciences de l’environnement, en épidémiologie et en géographie pour caractériser les arbres qui peuplent la ville. Cette équipe pluridisciplinaire a fait appel à différentes technologies, dont celle de points LiDAR. Cette technologie aéroportée envoie des impulsions vers le sol et indique la hauteur des objets bombardés. En ne conservant que les données concernant les arbres, la forêt urbaine a révélé ses caractéristiques : le nombre et la hauteur des arbres ou la distinction entre feuillus et conifères. Ils ont également utilisé les inventaires d’arbres de la Ville de Montréal.
En utilisant les inventaires, ils ont aussi tenté de cartographier les villes du monde possédant le plus d’espèces d’arbres qui causent des allergies. Les scientifiques se sont toutefois butés à un problème : « Il y avait des divergences incroyables entre les bases de données internationales. Selon la source que nous utilisions, nous obtenions des résultats complètement différents », raconte la chercheuse principale.
Par exemple, selon la base de données utilisées, la proportion d’arbres considérés comme très allergéniques à Montréal oscillait entre 1% et…74%! Les chercheurs ont d’ailleurs levé le voile sur cette situation dans Scientific Reports en 2021.
Comment expliquer une telle divergence? Les critères utilisés pour déterminer l’allergénicité des espèces semblent très variables. « Il faudrait vraiment définir une base commune pour dire qu’un pollen est allergénique ou pas », constate la chercheuse.
Encore une fois, la collaboration avec des chercheurs d’horizons variés a permis de voir la situation sous un œil nouveau. Par exemple, les écologistes ont proposé d’inclure la notion de dispersion des pollens à ces critères. En effet, certains pollens ayant un potentiel allergénique élevé causent peu d’inconvénients puisqu’ils sont émis à proximité de l’arbre. D’autres possèdent une configuration qui leur permet de voyager sur de très longues distances et peuvent potentiellement contaminer de plus grandes régions.
Il y a une urgence d’agir puisque, dans les grandes villes du monde, le pollen devient une préoccupation grandissante. De plus en plus de citoyens souffrent d’allergies et les choses n’iront vraisemblablement pas en s’améliorant. En effet, le réchauffement du climat devance et allonge la saison du pollen. De plus, l’augmentation de la concentration en CO2 stimule sa production.
En attendant des données plus concluantes, une solution subsiste pour réduire l’impact du pollen en ville : planter des espèces d’arbres variées, ce qui évite la production en très grande quantité d’une seule sorte de pollen. « Nos travaux soutiennent l’importance de planter des espèces diversifiées pour avoir une meilleure résilience face aux changements climatiques », confirme Audrey Smargiassi.
Le programme AUDACE a servi de levier afin d’obtenir un financement additionnel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour amorcer des travaux sur l’association entre les arbres et la santé respiratoire.
Nos travaux soutiennent l’importance de planter des espèces diversifiées pour avoir une meilleure résilience face aux changements climatiques.
Quelques chiffres clés :
14 espèces d’arbres
Elles représentent 90% de tous les arbres municipaux à Montréal. (Scientific Reports, 2021).
20%
La proportion de la population québécoise qui souffre d’allergies saisonnières.
Entre 156 et 240 millions de dollars