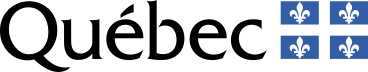Dans le bâtiment, les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) visent surtout les mesures d’efficacité énergétique et l’électrification du chauffage. Cependant, les bâtiments génèrent des émissions intrinsèques avant ou pendant leur construction, par exemple, lors de la fabrication ou du transport d’un matériau ou pendant les travaux.
En cette période où le Québec tente de diminuer ses émissions de GES tout en augmentant la cadence de la construction résidentielle, mieux connaître ces émissions intrinsèques devient crucial. C’est le défi que s’est donné Charles Breton, candidat au doctorat à la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois de l’Université Laval.
« On a besoin de données pour évaluer l’impact du parc immobilier actuel et futur sur nos émissions de GES et estimer les gains que l’on pourrait faire en construisant mieux ou avec des matériaux différents », explique-t-il.
Un modèle synthétique
Charles Breton a reçu une bourse Action climatique pour appuyer sa démarche. Il s’agit en fait d’un supplément de bourse pour des personnes inscrites au doctorat qui vise à soutenir des études directement liées aux travaux du Comité consultatif sur les changements climatiques.
L’originalité de ce programme consiste à mettre à contribution l’expertise et les conseils scientifiques de chercheuses et de chercheurs qui étudient au doctorat. Ces personnes doivent produire des rapports et des outils de communication pour soutenir le comité dans son rôle-conseil auprès du ministre responsable de la lutte contre les changements climatiques.
Le jeune chercheur a rapidement constaté la rareté des données sur notre parc immobilier. Il a donc créé un modèle synthétique pour le représenter. Afin de le calibrer, il a tenu compte du stock actuel de logements et du rythme des constructions et des démolitions. Il a aussi évalué les besoins futurs en employant des projections démographiques et en incluant les changements de mode de vie, par exemple, la réduction de la taille des ménages au cours des 125 dernières années.
Place à la sobriété
Un tel modèle permet, par exemple, d’estimer combien de logements seront construits ou démolis au cours des prochaines années. Il aide aussi à effectuer des analyses. « L’impact sur les émissions intrinsèques de GES varie en fonction du type de bâtiment, souligne Charles Breton. On doit donc faire le lien entre les besoins de logement de la population et le type de bâtiments qui serviront à y répondre. »
L’une des principales conclusions de ses analyses, c’est qu’à elle seule, l’adoption de nouveaux matériaux et de méthodes de construction innovantes ne suffira pas à atteindre nos objectifs de décarbonation d’ici 2050.
L’approche qui fonctionne, c’est la sobriété. On doit “consommer” moins de bâtiments, mais aussi loger une population croissante, ce qui est paradoxal. Mieux utiliser les logements existants et réduire le nombre de mètres carrés occupés par habitant, par exemple, en favorisant les maisons jumelées ou les appartements, demeurent des pistes intéressantes à explorer.
Pour aller plus loin :
- Scénarios québécois d’atténuation des impacts du bâtiment basés sur les matériaux, Charles Breton, Université Laval, 2022-2023
- Charles Breton et al., « A novel method to calculate SSP-consistent remaining carbon budgets for the building sector: A case study of Canada », Building and Environment, vol. 269, 2025, 112474.