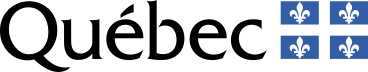Responsable :
William Lahaye
Établissement :
Université de Sherbrooke
Année de concours :
2024-2025
William Lahaye, responsable, Université de Sherbrooke
Secteurs de la recherche : Sciences humaines et sociales; Arts et lettres; Sciences naturelles et génie; Sciences de la santé
Domaine : Nature, transformation et gouvernance de la société et des institutions
Table des matières
1. RÉSUMÉ DU PROJET
La sobriété s’illustre par l’idée de « Moins, c’est mieux » et propose de réduire ou mettre fin à certaines pratiques (de consommation ou de production de biens et de ressources) avec l’objectif d’accroître la qualité de vie en ouvrant de nouvelles perspectives ou améliorant celles existantes. Mobilisée dans les projets et discours sur la transition énergétique, la sobriété interroge le lien entre la réduction des besoins individuels ou collectifs et l’accès à une forme de bien-être, mais s’accompagne de difficultés et de malaises vis-à-vis des privations et arbitrages forcés qui réduisent l’espace de choix des modes de vie pour les personnes déjà en situation de précarité. Au Québec, la question de la contrainte dans la transition énergétique s’incarne d’une part dans la dégradation accélérée des indicateurs environnementaux dont le territoire subit également les conséquences et, d’autre part, dans la marge de manœuvre réduite laissée par les moyens et ressources concrètement à disposition pour subvenir aux besoins de la transition environnementale telle que projetée actuellement à l’horizon 2050 par Hydro-Québec.
Ce projet de recherche s’intéresse au rapport entre la sobriété énergétique et l’accroissement de la qualité de vie. Les mentions de la sobriété dans les politiques québécoises de transition environnementale ne détaillent pas la façon dont l’application de cette notion peut réellement s’accompagner d’un accroissement de la qualité de vie, ce qui représente un impensé problématique. En ce sens, il semble toujours y avoir un vide normatif quant à la façon dont on peut déterminer et évaluer la dimension capacitante des politiques de sobriété énergétique (lorsqu’elles ne sont pas confondues avec l’efficacité énergétique).
L’objectif de ce projet de recherche est de se concentrer sur le déficit d’investigation éthique du lien entre sobriété et qualité de vie en proposant de réaliser un état des lieux des représentations actuelles de la sobriété et des potentiels de capacitation des citoyens. En sollicitant plusieurs organismes communautaires déjà engagés sur la question de l’énergie citoyenne au Québec, il s’agira d’organiser plusieurs consultations et entretiens avec des panels de citoyens dans l’optique d’obtenir des informations sur la façon dont la sobriété est décrite, vécue, représentée, et sur les besoins concrets auxquels ces personnes accordent de l’importance dans un contexte de pression sur les ressources environnementales et énergétique. D’un point de vue théorique, la démarche de recherche et le traitement des informations s’appuiera sur le cadre des capabilités d’A. Sen pour investiguer ce que pourrait produire la sobriété en termes de nouveaux espaces de choix d’opportunités à réaliser, par exemple dans le cadre des relations avec la collectivité, du rapport à l’environnement proche, des moyens de déplacement, de l’habitat, du lien entre le lieu de vie et l’état de santé. Le livrable extrait de ce projet visera à fournir des éléments pour mieux évaluer la possibilité d’un accroissement de la qualité de vie impulsé par une contrainte environnementale irréductible, de sorte à instruire la question de la participation à la transition écologique en termes de justice et de capacitation des individus et des collectifs.