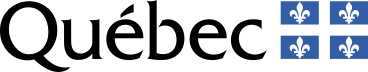Responsable :
Gohier, Maxime
Établissement :
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Année de concours :
2022-2023

Partenariat
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)
Programme de recherche en partenariat dans le secteur maritime – 1er concours
Table des matières
1. Résumé du projet
Notre programme de recherche s’intéresse aux traces mémorielles (documents, récits) et environnementales ainsi qu’aux vestiges archéologiques de la plus grande tragédie maritime du Saint-Laurent. En pleine guerre de Succession d’Espagne (1701-1713), les Anglais, désireux de conquérir la Nouvelle-France après la reddition de l’Acadie, décident d’attaquer Québec. Menée par l’amiral Walker, une flotte de 71 navires comprenant 6 000 marins et 7 500 soldats s’engage en août 1711 dans le golfe Saint-Laurent. Les conditions de navigation rendues difficiles par les vents et la brume, et l’absence de pilotes expérimentés auraient provoqué le plus important naufrage du Saint-Laurent : dans la nuit du 22 au 23 août, huit navires se fracassent contre l’Îleaux-Œufs, entre Baie-Trinité et Rivière-Pentecôte. La tragédie entraîne un nombre considérable de morts (entre 1 300 et 3 000, selon les sources) et le rejet sur les berges d’une quantité impressionnante de biens et de débris. Alors que les Anglais rebroussent chemin, les Français, soulagés, célèbrent l’issue inattendue de cette invasion avortée. La catastrophe improbable et d’une ampleur sans précédent frappe l’imaginaire des contemporains, comme l’attestent la documentation épistolaire, judiciaire, notariale et littéraire de l’époque.
Si cet événement de notre histoire nationale semble avoir laissé son empreinte auprès des populations côtières de l’est du Québec, il demeure étonnamment peu documenté par les scientifiques, toutes disciplines confondues. La trame événementielle reste nébuleuse, tout comme l’imaginaire qu’il a suscité. Les sites d’épaves connus – trois n’ont toujours pas été localisés – ont été depuis régulièrement pillés, et la majorité des artéfacts, dispersés. L’on ne sait rien non plus des phénomènes naturels à l’œuvre ni de leurs incidences immédiates et progressives sur les épaves et les débris du naufrage. C’est à ces questions que le projet souhaite répondre. Se donnant comme objet une part méconnue de notre histoire et de notre héritage culturel, il se propose d’étudier le naufrage de la flotte Walker et ses répercussions sous différents angles, depuis 1711 jusqu’à nos jours. Misant sur une approche favorisant le décloisonnement de la recherche sur le maritime, il fait converger autour d’un même objet plusieurs regards disciplinaires : histoire, archéologie, littérature, océanographie et géologie.
Cette mise en commun des expertises vise à mieux comprendre la trame événementielle de l’expédition Walker et à mettre au jour un pan de l’histoire et du patrimoine maritimes québécois.
En se proposant d’examiner la plus grande tragédie du Saint-Laurent dans une perspective pluridisciplinaire, intersectorielle et inter-milieux, le projet ne peut que générer de nouvelles connaissances. Il annonce une collaboration entre les milieux de la recherche et les populations locales, et témoigne de la pertinence d’une démarche intégrée qui, à la fois transversale et coopérative, génère une co-construction des savoirs avec les milieux de pratique et les communautés. Combinant la recherche fondamentale et la science citoyenne, le projet aura des retombées importantes pour la science, les communautés et la formation étudiante. Les activités d’animation et de diffusion qu’il prévoit (activités participatives, colloques, publications, etc.), quant à elles, trouveront échos auprès des différents publics à l’échelle locale, nationale et internationale.
2. Équipe de recherche
Équipe de recherche
Bernier, Marc André
Université du Québec à Trois-Rivières [UQTR]
Dumont, Dany
Université du Québec à Rimouski [UQAR]
Neumeier, Urs
Université du Québec à Rimouski [UQAR]
St-Onge, Guillaume
Université du Québec à Rimouski [UQAR]
Thuot, Jean-René
Université du Québec à Rimouski [UQAR]
3. Appel de propositions
Le projet est d’une durée de 4 ans et le montant total octroyé est de 380 992,00$