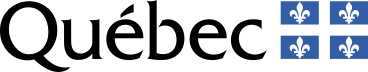Responsable :
Rochefort, Line
Établissement :
Université Laval
Année de concours :
2019-2020

Partenariat
Ministère de l'Énergie et Ressources naturelles
Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier – II
Table des matières
1. Projet
L’exploitation des ressources naturelles minières revêt une importance majeure dans les régions boréales et subarctiques au Québec. Toutefois, pour être durable et pour minimiser son impact environnemental et social, le développement minier doit être accompagné de la remise en végétation des sites dégradés après l’exploitation. Or, les méthodes de réhabilitation traditionnelle des sites miniers sont actuellement peu performantes sur les plans: 1) de la diversité végétale et 2) de la fonctionnalité des écosystèmes.
Objectifs
Par ce projet, nous proposons de développer une méthode de remise en végétation écologique plus holistique, facilement applicable à l’échelle du paysage et moins coûteuse pour les sites miniers recouverts de matériaux granulaires, tout en visant une stabilisation efficace des substrats. Notre approche vise à imiter les processus de succession écologique qui surviennent dans les sites naturels perturbés, afin d’accélérer l’établissement de communautés végétales diversifiées et typiques des régions nordiques. Deux composantes souvent oubliées dans la remise en végétation des sites miniers sont:: 1) le rôle des croûtes biologiques (un groupe d’organismes pionniers constitué d’algues, bryophytes, lichens, champignons et cyanobactéries) dans l’initiation de la régénération d’écosystèmes nordiques; 2) la diversité des microreliefs, souvent présents après les perturbations naturelles en forêt boréale.
Les objectifs du projet sont:
- D’évaluer l’effet de la modification de la microtopographie et de l’ajout de débris ligneux grossiers selon une méthode utilisée dans l’Ouest canadien, le Rough and Loose (R&L), associés à des amendements de sol (p. ex., matériel organique) sur les conditions édaphiques, microclimatiques et sur l’établissement de la végétation;
- D’étudier les croûtes biologiques de la région d’étude (d’un point de vue taxonomique) et les facteurs régissant leur distribution spatiale, puis de tester des méthodes de propagation et de réintroduction de croûtes biologiques.
Résultats attendus et retombées escomptées
Ce projet de recherche permettra de développer et d’optimiser une nouvelle méthode de remise en végétation par R&L pour les sites miniers localisés en régions nordiques. Les connaissances des processus de succession écologique et des filtres environnementaux régissant l’établissement de la végétation dans ce type d’écosystèmes perturbés seront approfondies. Tout le passif minier du Québec pourrait bénéficier grandement d’une méthode holistique et innovatrice qui aiderait à la réduction des impacts environnementaux, la mise en place d’un écosystème viable, durable et utilisable par les communautés locales, de même que la réduction des coûts associés à la remise en végétation. Ainsi, ce projet de recherche contribuera à modifier la perception de la population québécoise par rapport à l’industrie minière. En effet, l’approche proposée pour favoriser la mise en végétation ne visera plus seulement à végétaliser les superficies affectées par les activités minières, mais bien à « réparer » l’écosystème en favorisant le retour des fonctions et services écologiques associés à la forêt boréale.
À terme, ce projet de recherche générera des résultats qui contribueront à la durabilité de l’industrie minière, en réduisant l’empreinte écologique liée à ses activités. Le projet de recherche proposé repose sur un partenariat entre deux chercheurs de l’Université Laval, la compagnie de génie-conseil WSP et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
2. Équipe de recherche
Équipe de recherche
Rochefort, Line
Université Laval
Villarreal A., Juan Carlos
Université Laval
3. Appel de propositions
Le projet est d’une durée de 3 ans et le montant total octroyé est de 270 255 $.
4. Résumé et rapport de recherche
Considérant l’impact négatif des activités minières sur les communautés locales et les écosystèmes, la restauration des sites perturbés est essentielle. Les méthodes de végétalisation actuellement utilisées (p. ex., hydroensemencement d’espèces agronomiques, monocultures d’arbres) sont dispendieuses, peu adaptées et inefficaces, puisqu’elles ne conduisent pas à la régénération d’écosystèmes boréaux ou subarctiques diversifiés et viables à long terme.
L’objectif de ce projet était de développer une méthode de remise en végétation écologique plus holistique, facilement applicable et moins coûteuse pour les sites miniers composés de particules fines (sable et gravier) et visant une stabilisation efficace du substrat. Pour ce faire, une approche se basant sur les principes de succession écologique a été utilisée, soit le Rough and Loose (volet 1), que l’on peut traduire par « Décompaction et relief » (D&R), qui vise à décompacter le sol en créant une succession de buttes et dépressions. De plus, nous nous sommes intéressés à une communauté d’organismes négligée en restauration : les croûtes biologiques (volet 2), soit les communautés de bryophytes, de lichens, de bactéries et de champignons formant une couche adhérant au substrat minéral et essentielles à la formation des sols en milieu perturbé.
Pour le volet 1, l’approche Décompaction et relief a été testée dans six bancs d’emprunt (dépôts minéraux meubles utilisés pour la construction de routes) au parc national des Grands-Jardins et au site minier de Preissac, en combinaison avec l’ajout de débris organiques (bois raméal fragmenté, débris forestiers) et inorganiques (blocs rocheux). La présence d’une microtopographie, la décompaction des sols et l’ajout de débris forestiers ont permis une augmentation du couvert et de la diversité de la végétation. En l’absence d’amendement, l’approche D&R a permis une certaine recolonisation par des plantes pionnières, mais leur couvert est resté limité par rapport à l’état initial des sites.
Pour le volet 2, trois grands groupes de croûtes biologiques indigènes ont été identifiés : celles dominées par les cyanobactéries, celles par les lichens du genre Stereocaulon et celles par les mousses Racomitrium canescens et Stereocaulon spp. Ce gradient croissant d’état de succession écologique s’est avéré lié avec une diminution du magnésium, du potassium et du pH, et une augmentation de carbone et de la conductivité électrique. Dans un second temps, certaines de ces croûtes biologiques ont été récoltées puis propagées en serre pour tester différentes régies de culture, puis réintroduites sur le site minier de Preissac. En serre, l’ombrage et un régime hydrique humide ont favorisé la croissance des espèces de mousses et de cyanobactéries, alors qu’ils ont défavorisé les algues et les lichens. L’étude de la communauté bactérienne, basée sur la région ARN ribosomique 16S, a permis d’identifier les groupes bactériens les plus abondants des croûtes biologiques cultivées en serre : Proteobactéria, Cyanobactéria et Chloroflexi. Malheureusement, la réintroduction des croûtes biologiques à Preissac n’a pas été réussie en raison d’importantes dépositions aériennes sableuses.
En conclusion, la méthode Décompaction et relief (Rough and Loose) avec ajout de débris forestiers et de blocs rocheux semble favoriser l’établissement d’une communauté d’espèces végétales pionnières typiques de la forêt boréale, accélérant la succession écologique de ces sites perturbés, et ce, à moindre coût comparativement à la méthode conventionnelle d’hydroensemencement. Aussi, ce projet est l’un des premiers s’intéressant aux croûtes biologiques des zones boréales et subarctiques, et en contexte de restauration de perturbations minérales. Des avancées importantes ont été faites quant à l’amélioration des méthodes de propagation en serre, mais les méthodes doivent être peaufinées pour la réintroduction sur le terrain.