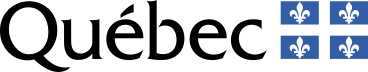Responsable :
Marie-Ève Gaboury-Bonhomme
Établissement :
Université Laval
Année de concours :
2022-2023

Partenariat
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Programme de recherche en partenariat – Agriculture durable – Volet II
Table des matières
1. Résumé du projet
Le Plan pour une agriculture durable 2020-2030 (PAD) propose de réduire de 500 000 kg les pesticides de synthèse vendus et de 40% leurs risques pour la santé humaine et l’environnement. L’atteinte de ces cibles pose des défis, notamment en regard des changements climatiques et des risques d’apparition de nouveaux ennemis des cultures. Pour atteindre ces cibles du PAD, il est nécessaire d’accélérer l’adoption des pratiques associées à la Gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC). La GIEC est une méthode décisionnelle qui peut s’intégrer dans plusieurs modèles d’agriculture (p.ex. conventionnelle, raisonnée, biologique). Elle prône l’utilisation prioritaire de pratiques de prévention et d’intervention alternatives à l’utilisation de pesticides de synthèse. Bien que la GIEC est l’approche privilégiée au Québec depuis plusieurs décennies, des sondages réalisés en 2012 et 2017 auprès des entreprises agricoles montrent que, bien que ces pratiques progressent, elles ne sont pas encore suffisamment adoptées, notamment dans les grandes cultures. La population québécoise, tout comme plusieurs expert.e.s agronomiques, s’expliquent mal pourquoi il n’y a pas encore une réduction massive des pesticides de synthèse aujourd’hui, près de 50 ans après le début du Réseau d’avertissements phytosanitaires au Québec et près de 29 ans après la première Stratégie phytosanitaire. La réponse est complexe et dépend de plusieurs facteurs macroéconomiques, sociologiques et politiques, facteurs qui ont été peu étudiés jusqu’ici au Québec, à l’exception de quelques recherches pionnières.
L’objectif de ce projet est d’identifier les freins et les incitatifs macroéconomiques et sociopolitiques pour atteindre les cibles du PAD à l’égard de la réduction des pesticides de synthèse.
A) Cibler les pratiques et les solutions qui ont le plus de potentiel pour atteindre ces cibles du PAD;
B)Faire un état des lieux des facteurs macroéconomiques et sociopolitiques qui freinent/incitent l’adoption à la ferme des pratiques et des solutions identifiées en A);
C)Prévoir les effets d’une réduction massive des pesticides de synthèse au Québec sur le système agroalimentaire, la santé de la population et l’environnement.
Pour poser des diagnostics précis et proposer des solutions innovantes adaptées à la réalité québécoise, un laboratoire de solutions sera formé, composé de 12 chercheur.euse.s (de cinq universités – Université Laval, McGill, UQAM, TELUQ, Bishop’s – et d’un centre de recherche – CEROM) et de plusieurs utilisateur.trice.s de la recherche (ministères, organisations, milieu agricole, agronomes, société civile, etc.). Il sera multidisciplinaire (agronomie, économie, politiques publiques, géographie, sociologie, biologie, santé publique et environnementale)et multisectoriel (grandes cultures, fruits, légumes). Plusieurs méthodologies de recherche complémentaires seront utilisées : revue systématique mixte de la littérature internationale; Delphi avec des experts; analyse thématique de la littérature grise traitant des politiques publiques; études de cas de trois filières/territoires; entrevues semi-structurées avec des informateurs clés; diagrammes de boucles causales; analyses de données secondaires, enquêtes par sondage auprès des productrices et des producteurs et des agronomes; modélisations à large échelle. Les résultats des différentes méthodes seront croisés et discutés au sein du laboratoire de solutions, pour s’assurer de la validité des résultats et proposer des solutions innovantes et adaptées à la réalité québécoise.
2. Équipe de recherche
Équipe de recherche
Gaboury-Bonhomme, Marie-Ève
Université Laval
Adamowski, Jan
Université McGill
Bissonnette, Jean-François
Université Laval
Cloutier, Jacinthe
Université Laval
Dale, Bryan
Université Bishop’s
Dureau, Romain
Université Laval
Fortin, Josée
Université Laval
Guillaumie, Laurence
Université Laval
Parent, Lise
TÉLUQ – Université du Québec
Séguin, Charles
Université du Québec à Montréal [UQAM]
Vandelac, Louise
Université du Québec à Montréal [UQAM]
3. Appel de propositions
Le projet est d’une durée de 4 ans et le montant total octroyé est de 1 270 000 $.