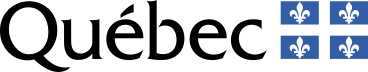NOUVELLE ÉDITION DU PROGRAMME ENGAGEMENT, NOUVELLES QUESTIONS !
Voici la page dédiée aux questions proposées par les citoyens et les citoyennes dans le cadre de la nouvelle édition du programme ENGAGEMENT du Fonds de recherche du Québec.
Les questions se rajouteront jusqu’à la mi-décembre, au fur et à mesure que les citoyens et citoyennes les soumettront.
Nous invitons la communauté de recherche à en prendre connaissance et à former un duo avec un citoyen ou une citoyenne pour proposer un projet de recherche. Chercheurs et chercheuses, une de ces questions vous interpelle ? Entrez en contact avec la personne citoyenne qui l’a posée en nous écrivant à: Engagement.gds@frq.gouv.qc.ca
Votre Duo est formé? La chercheuse ou le chercheur responsable de déposer la demande peut accéder au formulaire dans son Portefolio électronique FRQnet dès le 13 novembre 2025 (voir les détails sur la page du concours actuel)
Questions proposées par les citoyennes et citoyens au concours 2026-2027
Les questions seront diffusées ici au fur et à mesure qu’elles auront été soumises. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour en prendre connaissance.
Bien que le Fonds de recherche du Québec publie ce contenu, il n’en est pas l’auteur.
À noter: Les questions soumises dans les éditions antérieures du concours qui peuvent être consultées (ci-dessous) sont disponibles à titre d’exemples seulement.
Discrimination, inclusion, immigration
Comment une épicerie solidaire communautaire peut-elle faciliter l’inclusion des citoyens au sein de la communauté ?
Dans le contexte social et économique actuel, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à répondre à leurs besoins alimentaires et humains essentiels. Les épiceries solidaires communautaires représentent pour moi un espace concret d’innovation sociale et d’inclusion, où il est possible de concilier l’accès à l’alimentation avec la participation citoyenne, l’engagement et le sentiment d’appartenance.
Mon intérêt pour ce projet de recherche découle de mon engagement quotidien au sein d’une épicerie solidaire communautaire dans Rosemont. J’y observe les expériences vécues par les personnes citoyennes, les facteurs qui favorisent leur participation et leur bien-être, ainsi que les obstacles qui peuvent limiter leur inclusion. Ces constats m’amènent à vouloir approfondir ma compréhension de ces mécanismes et à identifier des pistes pour renforcer l’impact social de ces initiatives.
Collaborer avec une personne chercheuse permettrait d’apporter un regard extérieur et analytique sur cette réalité de terrain. Cette démarche combinera mon expérience pratique avec une approche scientifique rigoureuse, afin de documenter et d’analyser de manière systématique les dynamiques d’inclusion, le modèle de réponses aux besoins utilisés, les pratiques innovantes et les ajustements possibles pour mieux répondre aux besoins de la communauté.
Mon objectif est de contribuer à faire reconnaître et à développer ce type d’espaces inclusifs, tout en produisant des connaissances susceptibles d’inspirer d’autres initiatives.
Dans quelle mesure les activités parascolaires des organismes communautaires jeunesse favorisent-elles l’intégration sociale et linguistique des adolescentes et des adolescents nouvellement arrivés en classe d’accueil ?
Travaillant depuis 2 ans avec des jeunes en classe d’accueil qui sont de nouveaux arrivants, je me demande si mon travail apporte de la valeur à ces jeunes dans leur processus d’intégration. Aussi, sachant que d’autres organismes communautaires interviennent auprès d’autres nouveaux arrivants, je voudrais savoir s’il est possible de mutualiser les efforts pour une meilleure intégration des nouveaux arrivants notamment ceux en francisation.
Est-ce que les activités culturelles sont efficaces pour changer les stéréotypes et les préjugés envers les personnes immigrantes, surtout celles issues des minorités visibles ?
Je suis moi-même une personne migrante et membre d’une minorité visible. Dans ma vie professionnelle, communautaire et familiale, je constate quotidiennement l’existence de microagressions et de formes subtiles de racisme dans les milieux scolaires, de travail ou de loisir.
Ces expériences nourrissent ma conviction que l’éducation interculturelle et les pratiques culturelles sont des outils essentiels pour bâtir une société plus inclusive. Toutefois, aborder ces enjeux directement peut parfois susciter de la résistance : certains rejettent le dialogue en associant ces démarches au mouvement « woke ». C’est pourquoi je crois à la puissance transformatrice de la culture, capable de sensibiliser sans confrontation, par la création, l’émotion et le partage. Ce projet pourrait aider à mieux reconnaître la valeur des initiatives culturelles qui rapprochent les personnes et font évoluer les mentalités.
Éducation
Afin de mieux répondre aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité, comment améliorer le partenariat entre les parents et les intervenants scolaires pour coconstruire des solutions lorsque les moyens du plan d’intervention ne sont pas respectés?
Ayant vécu un sentiment d’injustice et d’incompréhension depuis le début du parcours scolaire de mon enfant neuro divergent, je sais combien il est difficile et décourageant de devoir se battre contre le système et de sentir que la réussite scolaire de notre enfant repose exclusivement sur nos épaules lorsque nous nous sentons laissés à nous-mêmes.
C’est pourquoi je désire m’associer à une personne chercheuse pour contribuer à mieux répondre aux besoins des enfants et de leurs parents qui vivent des situations d’iniquité et de vulnérabilité et influencer positivement des changements en éducation. Je crois que ma question fait office d’un projet d’innovation sociale à l’heure où le nombre de plans d’intervention augmente au Québec.
Comment les personnes analphabètes fonctionnelles de plus de cinquante ans se débrouillent-elles avec les outils de communication électronique ?
Je trouve incroyable que 46% des Québécois et des Québécoises soient encore analphabètes (fonctionnels ou non) et je suis curieux de savoir si les moyens de communication électronique les aident, sont sans effet, ou si ces moyens les excluent encore davantage. Ayant une formation en pédagogie et ayant enseigné à tous les niveaux, je suis très sensible à cette question de société qui me semble centrale dans notre histoire et notre avenir.
Comment l'intelligence artificielle générative peut-elle soutenir les enseignantes et les enseignants au primaire ou au secondaire dans leur planification de l'enseignement des mathématiques?
Possédant une expérience de plus de 20 ans dans le milieu de l’éducation québécois, mon parcours a débuté sur le terrain en tant qu’enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire. Depuis 2011, j’agis à titre de conseiller pédagogique, principalement en science et technologie (primaire et secondaire). Depuis 2013, j’agis comme personne-ressource pour le service local du RÉCIT.
Cette double fonction m’a permis de développer une expertise pointue à l’intersection de la didactique et de l’intégration des technologies numériques. J’ai coordonné de nombreux dossiers liés à l’intégration du numérique, incluant le déploiement de laboratoires créatifs (programmation, robotique, impression 3D), la formation sur les environnements numériques d’apprentissage, notamment Google Workspace, et la conception de formations en ligne pour Campus RÉCIT.
Comment mettre en place une procédure de rétroaction et de révision par les pairs afin de favoriser le langage écrit dans un groupe d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou d'élèves allophones ?
Depuis quelques années, j’enseigne auprès d’une clientèle ayant plusieurs difficultés d’apprentissage ou auprès d’élèves allophones. Leur langage écrit demeure un grand défi pour eux. Il est difficile, en tant qu’enseignante d’offrir une rétroaction efficace et immédiate pour les besoins spécifiques de chacun afin de favoriser les progrès. Les groupes sont hétérogènes et, malgré la mise en place d’ateliers d’écriture, d’enseignement explicite, de sous-groupes ou d’entretiens individuels, ma rétroaction auprès d’eux ne semble pas optimale.
Je me questionne, chaque année, quant à la meilleure façon de procéder pour améliorer ma rétroaction auprès d’eux et maximiser leur plein potentiel pour les faire progresser.
En m’informant sur le sujet, plusieurs experts ou auteurs de manuels mentionnent que la rétroaction par les pairs est efficace puisqu’elle soutient l’intérêt des élèves (Anne Rubbles Gere, 1987). Toutefois, cette rétroaction doit être structurée et dirigée (Elbow et Belanoff, 2000). À la suite de quelques lectures, bien que plusieurs idées et façons de faire soient énoncées, comment puis-je mettre en place une rétroaction et une révision par les pairs ? Quelles seraient les meilleures stratégies à mettre en place et à enseigner afin de rendre cette rétroaction stimulante, efficace et constructive pour les élèves?
C’est ainsi que ce sujet m’a intéressée et j’aimerais faire un projet de recherche afin d’approfondir cette question et de soutenir le grand défi qu’est l’écriture auprès des élèves ayant déjà plusieurs difficultés d’apprentissage ou n’ayant pas le français comme langue maternelle.
En quoi la difficulté dans certaines matières interfère-t-elle avec le parcours scolaire ?
Dans mon entourage, j’observe de plus en plus de jeunes ayant opté pour le décrochage scolaire. Des échanges avec ces jeunes me montrent que, la plupart du temps, ce sont quelques matières qui posent problème. Je m’interroge donc sur le décrochage scolaire des enfants et sur le modèle de l’éducation, qui date des années 1960 et qui est calqué sur un modèle plus antérieur.
Comment favoriser l'intégration d'élèves ayant des troubles neurodéveloppementaux complexes vers un milieu moins spécialisé?
Je travaille depuis une dizaine d’années dans une école pour les enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux complexes et des troubles graves du comportement. C’est une école de soutien transitoire intensif. Le mandat de celle-ci est de clarifier les diagnostics, de stabiliser et d’outiller les élèves pour ensuite les intégrer dans un milieu moins spécialisé. La transition entre notre école et les écoles moins spécialisées est très difficile. Nous avons de la difficulté à bien préparer les élèves à cette transition.
Environnement (écosystèmes, pollution, faune et flore)
Pour soutenir les communautés vivant en bordure d’un lac dans leur prise de décision, comment peut-on démontrer scientifiquement s’il existe un lien de cause à effet entre le retrait des embarcations motorisées et la diminution du nombre et de l’importance des épisodes de cyanobactéries ?
Notre lac a obtenu le retrait des embarcations motorisées fin 2017 pour des raisons de sécurité. Nous avions des conflits et des épisodes importants et récurrents de cyanobactéries. Depuis, les situations tendues ont disparu ainsi que les épisodes de cyanobactéries qui apparaissent très rarement et pas toutes les années. Nous vivons aussi dans un milieu tellement plus tranquille et très apprécié.
J’aimerais qu’une ou un scientifique se penche sur cette amélioration (diminution des épisodes de cyanobactéries) de la santé du lac et du plaisir que les gens en retirent.
Je suis sensibilisé et respectueux de l’environnement et j’apprécie énormément la tranquillité que cela nous a procurée. J’aimerais faire bénéficier de ces avantages à d’autres riverains.
Est-ce possible d'extraire les particules de plastique ou PFAS en suspension dans l'eau en utilisant leurs propriétés électrostatiques ?
Les PFAS sont d’importants pollueurs souvent sous forme de micro ou de nano particules et ont des effets importants sur la santé humaine. Je me disais, qu’en premier lieu, nous pourrions les récupérer le plus en amont possible pour limiter leur propagation et, en deuxième lieu, les récupérer dans différents plans d’eau où ils se sont accumulés à l’aide de différents outils tels que des capteurs dans les usines de traitements de l’eau et dans les bassins de décantation des eaux pluviales. Nous pourrions utiliser des drones ou des véhicules navals pour vider les plans d’eau. J’ai aussi lu des articles sur les boules de Neptune qui se gorgent de PFAS.
Est-ce qu’une partie du méthane détectée dans l’Arctique pourrait provenir de l’effet du déplacement des masses d’air qui comprimerait la matière poreuse (ex. la tourbe) contenue dans le pergélisol en dégel, de la même façon qu’on plongerait et comprimerait une éponge dans l’eau, libérant du CH4 lors des hausses de pression atmosphérique ?
Je travaille à l’occasion dans diverses communautés du Nunavut, ce qui me donne la chance de marcher sur le territoire et de l’observer. Il m’est arrivé d’être très impressionné par des bulles qui s’échappaient à certains endroits, au point de commencer à consulter les images satellites, comme celles de Sentinel-5P, et de les lier avec les données météorologiques du terrain. Sur le site du gouvernement du Canada, dans la section « concentrations des gaz à effet de serre », on dit que le méthane détecté dans l’arctique pourrait provenir des milieux humides tropicaux, en se basant sur des analyses de signatures isotopiques de CH4.
Je crois que de la matière organique peu dégradée de certaines tourbières du Grand Nord, engendre des émissions de méthane, autant dans les périodes de hausse de pression atmosphérique, par compression de la frange capillaire vers la nappe phréatique, libérant du CH4, que lors d’une baisse de pression favorisant l’ébullition des gaz dans les liquides. Et comme l’Arctique possède un potentiel d’émission important de méthane et que sa détection est croissante au fil des ans, il est important d’en comprendre la contribution non-anthropique et les déclencheurs.
Comment peut-on renforcer la capacité d’une plante à se protéger de façon naturelle et ainsi limiter l’usage de pesticides, d'engrais et d'herbicides ?
Passionnée de jardinage et ayant lu plusieurs écrits scientifiques sur le sujet, je me suis rendu compte que de plus en plus d’articles évoquent les nuisances des produits chimiques utilisés dans l’agriculture pour la santé. Certains vignobles ont dû arrêter l’utilisation de ces produits dans leurs vignes pour des raisons sanitaires. Ayant moi-même un jardin, j’ai eu l’été dernier l’expérience des scarabées japonais. J’ai réussi à les faire partir sans utiliser de produits chimiques. Je me demande donc comment les plantes peuvent mieux se protéger avec l’apport des micro-organismes sans recours à ces substances. Car pour moi, une plante saine, qu’il s’agisse d’un arbre, d’un arbuste, d’une plante ou d’un légume, me porte à croire qu’elle est bien plus bénéfique pour l’environnement et pour l’humain.
Existe-t-il pour les personnes riveraines vivant depuis une vingtaine d’années dans un quartier abritant un incinérateur, une susceptibilité accrue d’exposition à des composés émis par un incinérateur à déchets?
Depuis près d’un siècle, l’incinération a été le principal mode de gestion des matières résiduelles privilégié par la Ville et ça s’est poursuivi par la suite par la Communauté métropolitaine de Québec.
Le développement des connaissances et la littérature scientifique informent qu’un tel modèle de gestion par incinération génère des polluants atmosphériques. Selon la littérature scientifique, les installations d’incinération de matières résiduelles produisent des déchets gazeux et des cendres et contribuent à la pollution atmosphérique. Certains polluants provenant de l’incinération des ordures ménagères sont rejetés en grande quantité (ex. : les particules fines, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, etc.). D’autres polluants, même s’ils sont rejetés en quantités relativement moins importantes, s’accumulent dans les organismes vivants et ont des effets toxiques à moyen et long terme (ex. : les dioxines et furanes, l’hexachlorobenzène, les métaux lourds, etc.). Selon une étude de Santé Canada, « l’incinération à grande échelle des déchets municipaux et médicaux constitue la source la plus importante de dioxines et de furanes au Canada».
En 2021, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, mandatait le BAPE de tenir une enquête, avec audience publique, sur la gestion des résidus ultimes. Dans le cadre de son rapport final, concernant le volet de l’incinération, la Commission arrivait aux deux constats suivants :
1) L’incinération peut être source d’effets psychosociaux chez la population résidant à proximité et elle est d’avis qu’un suivi périodique auprès d’elle mériterait d’être effectué par le ministère de la Santé et des Services sociaux tous les 5 à 10 ans à des fins d’évaluation.
2) Le suivi des émissions atmosphériques des incinérateurs permet donc principalement de vérifier leurs qualités opérationnelles. Pour la commission d’enquête, un tel suivi apparaît comme étant totalement inadéquat pour l’évaluation de l’exposition des populations limitrophes. Cela va même à l’encontre d’un des principes du développement durable, soit santé et qualité de vie. Ainsi, il s’avère indispensable que le suivi permette d’évaluer de façon fiable le niveau de la contamination environnementale dans les environs des infrastructures d’incinération sur la base de critères rigoureux et qu’il comprenne des évaluations de l’exposition des populations limitrophes réalisées de façon récurrente pour la prise en compte des fluctuations spatio-temporelles des contaminants présents dans les émissions atmosphériques.
Afin d’assurer un meilleur suivi, la Commission recommandait que :
◦ Le MELCCC devrait exiger des exploitants d’incinérateurs de matières résiduelles des mesures directement sur le terrain qui permettent d’apprécier avec fiabilité la dispersion et les fluctuations spatio-temporelles des contaminants atmosphériques rejetés.
◦ Le MSSS devrait vérifier la présence ou l’absence de lien de causalité entre l’exposition des populations limitrophes et des problèmes de santé en procédant à des évaluations récurrentes jusqu’à l’obtention d’une preuve qui aura été jugée scientifiquement suffisante.
En 2024, selon l’Inventaire national des rejets de polluants du Gouvernement du Canada, l’incinérateur de la Ville de Québec a généré 502 tonnes de polluants atmosphériques : 395 tonnes d’oxyde d’azote (NOx), 47 tonnes de monoxyde de carbone (CO), 34 tonnes d’acide chlorhydrique (HCl), 9 tonnes de dioxyde de soufre (SO2), 1 tonne de particules fines (PM2,5), 12 grammes d’hexachlorobenzène (HCB), 12 tonnes de composés organiques volatils (COV), 0,1gÉT de dioxines et de furanes, et 0,59kg de mercure.
Tout comme moi, de plus en plus de citoyens et citoyennes sont inquiètes de l’impact de ce mode de gestion sur leur santé. Une inquiétude d’autant plus justifiée que depuis le rapport du BAPE de 2022, aucun suivi n’a été donné.
Comment l’agriculture communautaire peut-elle devenir un vecteur de solidarité sociale et, ainsi, contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’isolement social, tout comme au développement de la santé physique, mentale et environnementale dans une région rurale comme Charlevoix ?
Étant moi-même jardinier et conscient des effets positifs de l’horticulture sur ma santé mentale et mon bien-être, je m’intéresse depuis plusieurs années au rôle que peuvent jouer les jardins dans nos milieux de vie. À l’été 2025, dans le cadre d’un mandat professionnel qui m’a été confié à Charlevoix, j’ai réalisé un portrait des initiatives de jardinage collectif sur le territoire des deux MRC de Charlevoix et identifié les principaux freins et leviers à leur consolidation. Cette expérience m’a convaincu (ou plutôt reconvaincu) du potentiel de l’agriculture communautaire comme vecteur de solidarité sociale et de santé globale, au sens large.
Je souhaite aujourd’hui approfondir cette réflexion en collaboration avec une équipe de recherche, afin de mieux comprendre les retombées sociales et environnementales de ces initiatives, et d’utiliser les résultats pour renforcer, sur le terrain, la pérennité des projets de jardinage communautaire dans ma région. Mon objectif est de disposer d’arguments scientifiques solides pour sensibiliser les administrations publiques et les bailleurs de fonds à l’importance de soutenir ce type de projet collectif.
Comment établir la première liste d'espèces fongiques vulnérables et menacées au Canada ?
Les champignons jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes terrestres et aquatiques, en plus de représenter l’un des règnes les plus diversifiés du vivant. Pourtant, ils demeurent sous-représentés, voire totalement absents, de la législation environnementale québécoise et canadienne. Ainsi, la recherche sur la biodiversité fongique n’est soutenue par aucune institution académique ou gouvernementale, et repose essentiellement sur les regroupements citoyens que sont les cercles de mycologie. Je suis donc motivé à rapprocher les groupes citoyens qui ont à cœur la protection des champignons et le milieu de la recherche, afin d’initier un nouveau dialogue sur la biodiversité et de permettre la reconnaissance de la fonge au même titre que la faune et la flore.
Comment repenser la gestion hivernale de la mobilité urbaine afin d’assurer à la fois la sécurité, l’accessibilité et la durabilité des déplacements ?
Dans un contexte où le Québec consacre chaque année des centaines de millions de dollars au déneigement sans répondre pleinement aux attentes de la population, quelles sont les principales limites techniques, organisationnelles et environnementales des pratiques actuelles, fondées sur l’utilisation de sels, d’abrasifs et de machinerie lourde, et comment une meilleure compréhension des besoins des usagers, des contraintes climatiques et de la dégradation des infrastructures pourrait-elle orienter de nouvelles approches ? Enfin, comment citoyens, ingénieurs et décideurs pourraient-ils définir ensemble, à travers des démarches participatives et des outils de science citoyenne, des solutions intégrant des matériaux durables, des technologies intelligentes et des sources d’énergie renouvelable comme la géothermie, le solaire ou la récupération de chaleur pour bâtir un modèle de mobilité hivernale plus résilient, inclusif et écologique adapté aux villes nordiques du Québec? Ce qui me motive à poser cette question, c’est mon expérience quotidienne comme citoyenne de la Ville de Québec. Chaque hiver, je constate à quel point les conditions de déplacement deviennent difficiles : trottoirs glacés, passages piétons bloqués par la neige, autobus ralentis, personnes âgées isolées pendant plusieurs jours. Malgré les efforts et les investissements importants de la Ville, il reste souvent un sentiment d’impuissance et d’incompréhension face à la répétition des mêmes problèmes. Je m’intéresse à ce sujet parce qu’il touche directement notre qualité de vie, notre sécurité et notre environnement. Habiter dans une ville nordique comme Québec, c’est aussi apprendre à vivre avec l’hiver, mais je crois que nous pouvons le faire de façon plus intelligente, plus durable et plus humaine. Poser cette question dans le cadre du programme Engagement est pour moi une démarche citoyenne éthique : elle vise à comprendre avant de critiquer, à s’informer avant de juger et à contribuer plutôt qu’à subir. J’aimerais participer à un projet de recherche qui aide à mieux expliquer les contraintes du déneigement, à explorer de nouvelles solutions et à créer un dialogue constructif entre les citoyens, les chercheurs et la Ville. C’est une façon concrète de renforcer le lien entre la science et la société, au service d’un hiver plus sûr, plus durable et plus équitable pour tous.
Quels sont les facteurs qui influencent la tangente que prend le Québec en matière environnementale (coupes dans les budgets de fonctionnement, mises à pied de 134 fonctionnaires du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et recul sur les engagements en matière d’électrification des transports en faisant marche arrière sur l’interdiction de vente de voitures à essence dès 2035) dans un contexte où la crise climatique s'aggrave ?
Je travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l’environnement et je constate qu’il y a des reculs généralisés de nos gouvernements sur les questions environnementales. Par le biais de ce programme et avec la collaboration d’un chercheur, j’aimerais démontrer que le Québec pourrait s’aligner sur les pays progressistes en matière d’environnement et augmenter ses investissements tout en maintenant ses engagements. Ceci pourrait lui donner une position de chef de file en la matière alors qu’actuellement, il fait des reculs importants et ne fait que tabler sur son hydroélectricité pour défendre son bilan.
Quelles sont les causes du halo de pollution lumineuse au-dessus des villes la nuit et comment la participation citoyenne peut-elle contribuer à documenter et à réduire ce phénomène réduisant l’accès au ciel étoilé ?
À titre d’astronome amateur passionné et inspiré par la voûte céleste, je perds l’accès au ciel étoilé du côté de la ville. J’aimerais contribuer à réduire la pollution lumineuse et ainsi créer un environnement nocturne plus sain pour la santé humaine, les écosystèmes et ma pratique amateur de l’astronomie. Afin d’y arriver, j’ai cherché à mesurer la qualité du ciel nocturne chez moi. Cette démarche m’a sensibilisé à la problématique de la pollution lumineuse, m’a amené à me questionner sur ses causes et m’a motivé à chercher comment mobiliser mes concitoyens pour réduire l’impact négatif de la pollution lumineuse. Lorsque j’ai découvert le projet de protection de l’environnement nocturne de l’oasis de nuit étoilée du parc du Mont-Bellevue à Sherbrooke, j’y ai vu un espoir de retrouver la qualité de ma nuit et j’ai ressenti un fort désir de contribuer à ce changement.
Génie des matériaux, technologie, informatique
Comment la technologie numérique et l'intelligence artificielle pourraient soutenir de façon personnalisée les personnes immigrantes en région dans leur processus d'intégration dans la société d'accueil?
Je travaille dans le milieu communautaire à l’intégration des personnes issues de l’immigration dans la région de Chaudière-Appalaches et j’ai constaté que plusieurs familles peinent à trouver des informations sur leur processus d’immigration. Au Québec, les changements constants apportés aux lois sur l’immigration au cours des dernières années produisent une forte désinformation pour les personnes immigrantes ayant des statuts d’immigration différents. Cela rend difficile l’accès à une information fiable et provoque une confusion qui affecte à la fois leur qualité de vie et leur intégration dans la société québécoise. Dans ce contexte, la technologie numérique et l’intelligence artificielle peuvent avoir des effets positifs sur l’accès aux ressources et aussi sur leur bien-être global.
Je souhaite résoudre cette problématique avec l’appui d’un chercheur en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes issues de l’immigration dans notre région.
Quel est le potentiel des panneaux solaires en matière de performance hivernale, de coût et de durabilité dans les régions à climat froid comme le Québec ?
Je m’intéresse à la transition énergétique au Québec et, plus particulièrement, au rôle que peuvent jouer les panneaux solaires fabriqués localement dans un contexte de décarbonation et de souveraineté énergétique. Le Québec dispose d’un potentiel important en énergie solaire, même en climat nordique, mais l’adoption de celle-ci demeure limitée et la production industrielle locale reste émergente.
Cette situation soulève plusieurs questions citoyennes essentielles :
– Les panneaux solaires disponibles sur le marché sont-ils adaptés aux conditions climatiques du Québec (froid, neige, variabilité saisonnière) ?
– Quels sont les avantages environnementaux potentiels à développer une filière locale plutôt que d’importer des panneaux fabriqués à l’étranger ?
– Quels obstacles techniques, économiques ou sociaux freinent l’adoption par les ménages, les entreprises ou les communautés ?
– Comment favoriser une transition énergétique inclusive, notamment pour les régions rurales et les communautés nordiques ou éloignées ?
Cette question est directement liée à mon expérience personnelle et professionnelle au Québec, où j’ai observé un intérêt croissant pour l’énergie solaire, mais aussi une difficulté à obtenir des informations fiables sur la performance réelle des panneaux en conditions hivernales et sur leur rentabilité dans un contexte local.
Je souhaite donc contribuer, en tant que citoyen, à la production de connaissances utiles, accessibles et ancrées dans la réalité québécoise. Mon objectif est d’explorer, en collaboration avec une chercheuse ou un chercheur expert du domaine, comment les panneaux solaires peuvent devenir une solution énergétique durable, compétitive et adaptée aux territoires du Québec, tout en soutenant le développement économique local.
Comment les technologies, telles que l’intelligence artificielle, peuvent-elles aider les personnes aînées immigrantes à améliorer leur santé et leur bien-être au Québec ?
Ce qui me motive à poser cette question, c’est la conviction que les technologies, notamment l’intelligence artificielle, peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes aînées immigrantes, qui font souvent face à des barrières linguistiques, culturelles et sociales dans l’accès aux soins. Mon intérêt pour ce sujet découle de mon expérience de recherche et de terrain, où j’ai constaté à la fois les besoins non comblés de cette population et le potentiel des outils numériques pour favoriser une meilleure inclusion et une meilleure équité en santé. C’est pourquoi je souhaite collaborer avec un chercheur ou une chercheuse : afin de développer un projet rigoureux et ancré dans la réalité, qui puisse réellement contribuer à réduire les inégalités et à offrir des solutions concrètes et adaptées.
Quels sont les freins techniques, économiques, réglementaires et stratégiques à l’implantation d’un système modulaire de batteries pour véhicules électriques?
Mon questionnement m’est venu il y a plusieurs années, en 2019, quand j’ai dû m’acheter un véhicule plus gros que ma Matrix 2006, de plus de 300 000 km, afin de tirer une petite roulotte, une Mini 13 de Prolite.
Comme ça faisait des années que je suivais les avancées sur les véhicules électriques ou à l’hydrogène ou solaires et que j’ai à cœur l’environnement pour nous et ceux qui vont nous suivre, je me suis arrêté pour voir si une telle technologie ou un tel véhicule pouvait répondre à mes besoins. Il n’y en avait aucun qui n’était pas à l’essence. On amène nos petits-enfants en camping et ça fait beaucoup de bagages, en plus des personnes. Seul un pickup à essence pouvait répondre à notre besoin. Donc j’en ai acheté un usagé. Mais en creusant la question, j’ai fini par arriver à la conclusion qu’aucun type de véhicule écologique offert sur le marché était adéquat pour combattre les émissions de gaz à effet de serre, combattre les polluants de toutes sortes ou économiser les ressources.
Le système à l’hydrogène est une merveille, mais il coûte une fortune en énergie. Pour être produit, il est extrêmement dangereux à manipuler et même avec peut-être les nouvelles sources d’hydrogène emprisonnées dans les formations souterraines, la molécule d’hydrogène est trop petite pour ne pas s’échapper de la majorité des contenants que l’on utilise.
Les panneaux solaires sont trop peu efficaces en production d’énergie actuellement et il n’y a pas encore de solution assez efficace envisagée aujourd’hui.
Il reste les voitures électriques avec des batteries ou autres choses pour transporter l’énergie avec l’auto ou à l’auto en déplacement. C’est présentement à mon humble avis la meilleure technologie et porte de sortie d’un point de vue écologique. À ce que j’ai lu, aucun système de câbles ou de rails pour amener l’énergie à l’auto en déplacement est au point ou en voie d’être au point et les pertes d’énergie ou les dangers sont trop grands. Alors il reste les véhicules électriques avec batteries, mais, il y a des embûches majeurs au véhicule électrique à batterie.
Oui, au Québec, on a l’énergie hydroélectrique pas chère et non polluante, en tout cas, peu polluante et qui ne produit pas de déchets radioactives, mais penser qu’on va faire quelque chose de valable pour l’environnement de la planète avec nos petits barrages au Québec est utopique. Ce qui doit être fait, doit être exportable, partout ou presque, ne doit pas dilapider plus que nécessaire nos ressources et doit polluer le moins possible!
Les voitures électriques avec des batteries aux ions sont actuellement la solution la plus aboutie et valable, en attendant d’avoir mieux. Mais charger tous les véhicules de la quantité de batteries nécessaire pour faire des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres quand la majorité des déplacements sont de seulement quelques kilomètres ou de dizaines de kilomètres est une très bonne mauvaise idée à mon sens!!!
Puis, presque tous les pays de la terre se tournent vers les éoliennes ou les panneaux solaires, selon leur climat ou leur situation géographique, tout en conservant l’hydroélectricité, l’énergie nucléaire et les centrales aux énergies fossiles. Mais le solaire et l’éolien demandent d’avoir une façon d’accumuler de l’énergie quand il n’y a pas de vent ou qu’il ne fait pas soleil!
Philosophie, droit, art
Comment peut-on mesurer et traduire musicalement les stimuli tels que le vent, la lumière, la chaleur, l'eau, le bruit et le toucher perçus par les végétaux ?
Depuis un peu plus d’un an, je m’intéresse et expérimente la “musique végétale”. Pour ce faire, je me connecte à différentes plantes via un appareil qui est disponible commercialement et qui permet de traduire un signal émis par la plante en signal MIDI me permettant ainsi de composer, à l’aide de logiciels, une musique numérique. Bien que cela soit joli, beaucoup de questions me viennent concernant l’origine de ces sons.
L’appareil que j’utilise génère des signaux qui me font douter de leur représentativité quant à ce qui se passe réellement dans la plante. En effet, des sons très similaires peuvent être générés alors que le contexte est très différent et vice-versa. J’ignore donc à quel point les mesures sont manipulées et transformées par l’appareil pour générer des sonorités qui seraient plaisantes à l’oreille et, par conséquent, si ces sons sont réellement liés à des signaux détectés chez la plante. Peut-être qu’ils ne sont que le produit d’une programmation humaine ? J’aimerais connaître davantage le fondement scientifique de ce type de mesure et savoir à quel point l’appareil que j’utilise présentement génère des sons qui ont un lien avec les mesures provenant des électrodes fournies. Enfin, en plus d’avoir des doutes sur la valeur réelle des appareils destinés au grand public, ceux-ci sont très dispendieux.
À terme, j’aimerais qu’un public plus large puisse être exposé à la création musicale végétale qui serait inspirée de signaux réels provenant de ces organismes « sans voix » que sont les plantes. Les végétaux sont présents dans notre quotidien, à la maison, dans nos quartiers et sont très affectés par divers problèmes environnementaux. À court terme, ce projet m’aidera à valider et à mieux comprendre certains éléments essentiels à mes créations ainsi qu’à élargir mes horizons scientifiques et artistiques. Ultimement, ce projet pourrait nous aider à sensibiliser le public à la sensitivité des plantes tout en soutenant notre reconnexion à l’environnement naturel.
Quels sont les bienfaits de la participation à un projet artistique intergénérationnel pour les personnes aînées en CHSLD et pour le personnel soignant ?
Mes quinze années d’expérience, en tant qu’infirmière en CHSLD, notamment dans le Centre-du-Québec, m’ont amenée à observer que les lieux de vie des personnes aînées cheminant vers la mort sont trop souvent peu accueillants, peu chaleureux ou peu représentatifs des personnes vulnérables qui y habitent.
Ces environnements stériles et inhospitaliers ont également un impact sur la qualité de vie au travail, sur la santé mentale des personnes soignantes ainsi que sur le lien entre les personnes aînées et les personnes soignantes, lequel peut difficilement être personnalisé dans ce contexte.
En particulier, dans nos milieux ruraux, je constate une faible exposition des personnes aînées et de leurs familles aux arts du fait du manque d’occasions et de lieux de diffusion des arts et de la culture, mais aussi en raison du manque de familiarité des individus avec les lieux culturels existants.
Pourtant, aujourd’hui, en tant qu’artiste et médiatrice culturelle, je suis convaincue du rôle des arts et de la culture pour se relier davantage les unes aux autres, en particulier entre des générations peu amenées à se côtoyer. J’en ai d’ailleurs personnellement fait le constat à travers le projet de médiation culturelle intergénérationnelle que je mène, les Portes qui parlent.
Il y a de plus en plus de volonté des municipalités de mettre en contact l’ensemble des personnes citoyennes avec les arts et la culture, y compris par des interventions hors les murs, dans les espaces publics et dans les milieux de vie. Au-delà d’une offre de loisir ponctuelle en résidence, je crois que ces initiatives gagneraient à être mieux documentées pour soutenir leur pleine intégration dans les processus de soins aux personnes âgées. Je souhaite donc m’associer à un chercheur ou à une chercheuse afin de soutenir le développement de connaissances sur les effets des initiatives culturelles intergénérationnelles en milieu de soins, et favoriser leur diffusion auprès de tous les publics, en particulier les décideurs du secteur de la santé et des services sociaux.
Comment l’émerveillement, entendu comme l'expérience esthétique d’ouverture et de présence au monde, se reconfigure-t-il lorsqu’on passe de la lecture d’une œuvre littéraire, fondée sur la médiation du langage et la temporalité de la narration, à l’interaction avec une œuvre d’art essentiellement non verbale?
Ma fascination pour la notion d’émerveillement tire son origine d’une expérience marquante vécue à l’adolescence. Alors que je traversais un épisode de maladie grave, la lecture d’un poème d’Arthur Rimbaud a provoqué en moi un sentiment d’émerveillement d’une intensité bouleversante dont je suis resté marqué à tout jamais. En quelques vers, j’ai senti brusquement ma perception du monde s’approfondir, mon sentiment d’exister s’intensifier. Cette expérience décisive, à la fois esthétique et existentielle, a radicalement transformé mon rapport intime à la vie et à la maladie, en plus de déterminer sur-le-champ ma vocation littéraire.
Depuis, j’ai souvent été amené à me questionner sur la nature et les conditions de ce phénomène. L’émerveillement découle-t-il d’une disposition intérieure propre à la personne ou bien réside-t-il dans certaines qualités formelles de l’œuvre elle-même ? Autrement dit, que se passe-t-il réellement lorsqu’on s’émerveille au contact d’une œuvre d’art ? Mon questionnement s’est approfondi au fil de ma pratique d’écriture et de mes études en histoire de l’art où mon intérêt se portait d’abord et avant tout sur les dimensions philosophiques et esthétiques de l’expérience artistique.
En parallèle de la littérature, j’ai souvent éprouvé une expérience similaire au contact de formes d’art non verbale, comme la peinture, la sculpture, la musique ou l’architecture, tout en constatant néanmoins que l’émerveillement littéraire s’en distingue fondamentalement. Dans la lecture, me semble-t-il, l’émerveillement s’inscrit principalement dans la durée, médié par le langage et la temporalité du récit tandis que les arts non verbaux agissent plutôt dans l’immédiateté du contact sensible avec l’œuvre, par la force directe de la matière ou de la forme. Cette distinction a nourri chez moi une curiosité grandissante pour l’émerveillement et les mécanismes qui le rendent possible.
Récemment, des échanges nourris avec une professeure-chercheuse en design ont ravivé et précisé ma curiosité pour ce sujet. Ensemble, nous en sommes venus à nous demander ce qu’il en est concrètement de l’émerveillement : comment se manifeste-t-il selon qu’il passe par les mots ou par des formes d’expression non verbale ? Quelles différences perceptuelles, émotionnelles et cognitives distinguent l’expérience esthétique de la lecture de celle de l’interaction avec une œuvre d’art pour ainsi dire « muette » ? Ces discussions ont éveillé en moi le désir de confronter ma sensibilité d’écrivain à une approche de recherche scientifique et interdisciplinaire.
Dans une société marquée par la saturation médiatique et la fragmentation de l’attention, l’émerveillement m’apparaît de plus en plus comme un moyen nécessaire de résistance culturelle à la distraction généralisée qui caractérise notre époque. Interroger notre capacité à s’émerveiller, c’est aussi, en un sens, chercher à comprendre comment l’art peut encore, de nos jours, nous apprendre à voir, à ressentir et à penser toujours autrement, bref à s’insurger sans relâche contre le désenchantement et l’indifférence.
Comment la danse, en activant notre attention au corps et aux autres, peut-elle permettre de résister à la fragmentation numérique et d'inspirer de nouvelles formes d’intelligence collective ?
Ce qui me pousse à poser cette question, c’est une prise de conscience – et peut-être aussi une peur – de voir s’éroder, peu à peu, notre rapport au corps et à l’expérience physique partagée. J’ai l’impression qu’en tant que société, nous nous éloignons du corps vivant, du corps collectif, pour glisser vers une forme d’existence de plus en plus numérique. Cette transformation se fait doucement, presque imperceptiblement, mais elle me semble inévitable.
Or, je crois profondément que la présence physique ensemble — dans le mouvement, dans la danse, dans l’attention aux autres corps — peut résister à cette déconnexion. Être physiquement ensemble active une forme d’intelligence intuitive, une mémoire inconsciente du corps collectif qui nous rappelle que nous existons les uns avec les autres, que nous partageons une même condition, une même organicité.
Le numérique nous relie, mais paradoxalement, il nous isole aussi. Il nous connecte à distance tout en affaiblissant la cohésion du vivant, la trame invisible qui relie les corps entre eux. J’ai le sentiment que cette fragmentation numérique alimente l’individualisme contemporain et affaiblit notre capacité d’empathie et de résonance commune.
La danse, par sa nature, propose un espace de résonance collective. Qu’on danse ou qu’on regarde danser, nos corps réagissent ensemble, s’ajustent, se répondent. Dans une salle de spectacle, un mouvement, un souffle, une phrase chorégraphique peut susciter une réaction partagée. Ce réseau de réactions forme une intelligence collective sensible, une forme de « réseautage cognitif » qui nous relie entre nous et à ce que nous sommes fondamentalement : des êtres sensibles, pensants et incarnés.
Mais comment décrire, analyser et comprendre cette expérience du corps collectif ? C’est ici que la collaboration avec une chercheuse ou un chercheur devient essentielle. Là où la pratique artistique ouvre des espaces d’intuition et de ressenti, la recherche peut offrir des outils pour observer, traduire et approfondir ce qui se joue dans ces moments de résonance partagée. Ensemble, nous pourrons explorer comment la danse, en activant l’attention au corps et à l’autre, peut inspirer de nouvelles formes d’intelligence collective et contribuer à repenser le vivre-ensemble à l’ère numérique.
Ce projet de recherche naît donc d’un espoir : celui de comprendre si la danse peut contribuer à préserver — ou à réactiver — cette mémoire empathique du corps collectif. Peut-elle ralentir la mutation vers une identité humaine de plus en plus désincarnée, presque exclusivement numérique ? J’y vois une opportunité où la science et la danse se rejoignent pour nourrir des formes nouvelles de cohésion sociale et penser autrement notre manière d’être ensemble.
Politique et société
Compte tenu du contexte actuel du logement, est-ce que la Société d’habitation du Québec respecte sa mission, en conformité avec son mandat?
La situation actuelle du logement soulève une problématique avec la mission, la gouvernance et la gestion de la Société d’habitation du Québec (SHQ). D’abord, l’importance de la question ici est en lien avec le logement qui est un besoin essentiel. Puis, la qualité de sa gestion se pose avec acuité dans le contexte actuel, notamment par rapport aux besoins de logement, aux immeubles existants et au contrôle des offices d’habitation (OH) et des OSBL bénéficiant de ses subventions.
Comment assurer la pérennisation et la centralisation des objets, des pratiques et des résultats de recherche des généalogistes au Québec, et veiller à leur diffusion vers l’ensemble de la société québécoise?
Le Québec a la chance de compter plus de 20 000 généalogistes répartis en une centaine de sociétés à travers son territoire et en majorité regroupées sous la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. La pérennisation du patrimoine en histoires de familles, minutieusement mais passionnément construites par les généalogistes depuis plus de 70 ans, est d’une importance capitale du point de vue historique, patrimonial, culturel et social. Il semblerait donc logique que le grand public puisse disposer de moyens modernes et efficaces de conservation, de diffusion et de partage de ce patrimoine, de manière gratuite et durable.
Toutefois, entièrement administrées et soutenues par des bénévoles, ces sociétés font face à sept importants défis :
1. La fragilité des organismes en science généalogique au Québec, en raison de l’insuffisance de la relève et des difficultés de recrutement
2. La pérennité de la mémoire collective, des patrimoines familiaux et de l’histoire culturelle du Québec en l’absence de structure globale permettant la conservation des documents
3. La valorisation des connaissances généalogiques et historiques au-delà de la simple chronique des lignées alors qu’elles permettent de mieux comprendre l’évolution des sociétés et des structures économiques, politiques et sociales du Québec
4. La pérennisation d’un patrimoine toujours vivant et en évolution
5. L’accès démocratique à la culture généalogique et à l’histoire de nos familles
6. La facilitation des projets collaboratifs de recherche
7. La transparence et l’intégrité du travail avec les archives
La pérennisation du patrimoine en histoires familiales est essentielle pour préserver la mémoire des ancêtres, valoriser l’identité familiale et culturelle, et enrichir la compréhension de l’histoire collective. Grâce au travail des généalogistes, nous pouvons nous reconnecter à notre passé, en apprendre davantage sur nos origines, et assurer la transmission de cette richesse historique aux générations futures. C’est également un moyen de contribuer à un monde plus inclusif, plus informé et plus respectueux des héritages familiaux et culturels, tout en renforçant les liens entre les individus et les générations.
Comment la participation active à des ateliers de création littéraire, en tant que processus collectif et continu d’expression et de partage, peut-elle durablement renforcer le pouvoir d’agir des personnes en situation d’itinérance et contribuer à leur inclusion sociale au sein de la communauté à Rouyn-Noranda ?
Revenue m’installer à Rouyn-Noranda en 2024 après plus de vingt ans à Montréal, la situation de l’itinérance m’a interpellée tout de suite. L’itinérance visible est un phénomène assez récent à Rouyn-Noranda et la population doit s’adapter à cette nouvelle réalité. En tant que coordonnatrice de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, je suis aux premières loges pour observer les changements sociétaux. La bibliothèque étant un lieu gratuit et ouvert à tous, elle sert plus souvent qu’à son tour de refuge pour les personnes les plus vulnérables.
À l’automne 2024, la Bibliothèque a déposé un projet de mini-magazine rédigé par des personnes en situation d’itinérance afin de faire connaître leurs réalités aux citoyens. Depuis, nous avons travaillé avec une dizaine de personnes recevant les services des ressources en matière d’itinérance, et nous avons découvert des gens résilients, éprouvés, mais toujours debout. Les participants ont utilisé ces pages pour nous offrir des extraits de leur parcours et les textes m’ont touchée, émue, surprise. Les intervenants qui sont en relation avec les participants nous ont dit combien le projet était positif pour eux. C’est pourquoi j’aimerais pousser la question afin de savoir si ces effets positifs seront ressentis à long terme, si la démarche aura un effet durable sur la vie de ces personnes. Si c’est le cas, nous pourrions envisager de faire le même exercice avec d’autres groupes vulnérables et marginalisés.
De quelle manière l’intégration de pratiques d’économie circulaire dans la gestion des achats et des équipements d’un collège peut-elle contribuer à réduire l’empreinte carbone institutionnelle et à renforcer la culture organisationnelle en matière de développement durable ?
En tant que citoyenne engagée et responsable de l’entretien du bâtiment avec un mandat en développement durable, je suis particulièrement interpellée par certaines pratiques actuelles du collège. J’ai observé plusieurs problématiques : une gestion inadéquate des déchets liés aux équipements, une accumulation de matériel inutilisé et un tri déficient des matières résiduelles. Ces constats soulèvent des enjeux importants tels que le gaspillage de ressources, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une incohérence entre les valeurs éducatives du collège et ses pratiques concrètes.
Ces enjeux me motivent à proposer et à appuyer un projet citoyen visant à intégrer des pratiques d’économie circulaire dans les processus d’achats, de gestion et de disposition des équipements. L’objectif est de réduire l’empreinte écologique du collège tout en renforçant sa culture organisationnelle durable et responsable.
Comment pourrait-on, dans la société québécoise, aider à la stabilité et à la sécurité des femmes en situation d'itinérance qui sortent des maisons d'hébergement? Qui sont les intervenants qui devraient être impliqués, y compris les femmes ayant elles-mêmes une expérience personnelle d'itinérance?
Ce qui me motive à poser cette question est, qu’ayant moi-même été en situation d’itinérance, un soir j’ai été obligée de me louer une chambre à l’hôtel Chablis et, cette nuit-là, j’ai été victime de viol. Aujourd’hui, j’ai beaucoup d’anxiété et je suis devenue très insécure, même à ma sortie de l’itinérance. C’est ce qui m’amène à m’intéresser à ce sujet et à vouloir faire un projet avec un chercheur ou une chercheuse.
Dans quelle mesure est-il possible de mettre en place un environnement d’échanges commerciaux durable et mutuellement bénéfique entre les entreprises québécoises du secteur de l’aluminium et les marchés africains, en tenant compte des facteurs économiques, politiques et logistiques ?
En tant que Québécois, mon plus grand souhait est de voir le Canada s’ouvrir à un plus grand marché avec des partenaires sérieux et fiables et devenir la première puissance économique mondiale dans un avenir proche, afin d’être moins dépendant du marché instable avec nos voisins du Sud et de permettre aux entreprises canadiennes ou québécoises et aussi africaines de prospérer ensemble !
Étant donné que la chanson est le reflet de l'histoire sociale, comment pourrait-on favoriser l'écoute de chansons québécoises francophones chez les ados du Québec, de façon à leur faire mieux comprendre les particularités de leur culture et la richesse de leur patrimoine immatériel ?
Depuis l’avènement du Web et la quasi-disparition des supports physiques de chansons, l’offre à laquelle ont accès les ados du Québec est essentiellement anglophone, surtout étatsunienne. Comme les jeunes ne consomment pratiquement plus la radio, les règles de contenu francophone du CRTC n’ont pas d’effet sur eux. Ce phénomène contribue à affaiblir la spécificité culturelle du Québec puisque c’est à l’adolescence qu’on détermine ses choix musicaux, qu’on se forme comme citoyen ou citoyenne et qu’on assoit ses valeurs. Si on veut que les ados d’aujourd’hui deviennent des citoyens plus éclairés et plus sensibles à leur histoire, un des outils serait de leur faire connaître les chansons qui ont reflété des périodes marquantes de leur passé collectif. Et pour y arriver, il faut améliorer la découvrabilité des chansons québécoises. Ce n’est pas seulement une question de marché et d’industrie, mais aussi de survie culturelle.
Si je m’intéresse particulièrement à ce phénomène, c’est que j’ai été moi-même nourri de ces chansons. Un événement, une phrase, un paysage me rappelle directement un vers, un air. La chanson imprègne ma pensée. Je dirais même qu’elle a beaucoup contribué à la former.
Sans compter qu’étant moi-même auteur-compositeur-interprète, il m’est de plus en plus difficile de trouver des musiciens s’intéressant à la chanson à texte. La plupart des gens ne sont touchés que par la musique, ce qui me paraît aussi être un risque pour la culture franco-américaine. Plusieurs francophones écrivent leurs chansons en anglais. J’ai même connu une enfant qui s’étonnait qu’on puisse chanter en français!
Dans quelle mesure la fréquentation d’une salle d’entraînement influence-t-elle les trajectoires de vieillissement ? Étude de cas des personnes aînées.
Ma question de recherche découle directement de mon expérience comme entraîneur dans une salle d’entraînement communautaire montréalaise. Ce gym est un lieu très diversifié sur le plan culturel et social, où s’est formée au fil des ans une communauté de personnes aînées qui s’entraînent ensemble chaque matin.
Quels sont les effets de la création artistique sur la réduction des inégalités sociales, spécifiquement sur les enfants en situation vulnérable?
Depuis plusieurs années, je constate à travers mon travail d’artiste en arts visuels et d’animatrice d’ateliers que l’art a un pouvoir transformateur unique, particulièrement auprès des enfants en situation de vulnérabilité. Qu’il s’agisse de nouveaux arrivants, d’enfants vivant en contexte de précarité ou bénéficiant de la pédiatrie sociale, l’art agit comme un levier puissant pour favoriser leur expression personnelle, leur intégration et leur bien-être global. Mon implication découle de la conviction profonde que l’accès à des initiatives artistiques peut changer des vies et qu’il est impératif de soutenir ces initiatives par des ressources adéquates. Je souhaite qu’une recherche rigoureuse mette en lumière ces bénéfices pour encourager les organismes publics et les gouvernements à investir davantage dans ces programmes essentiels.
Comment la compréhension du fonctionnement du cerveau grâce à la neuropsychologie peut permettre la prévention contre l’épuisement, qu’il soit professionnel, émotionnel, familial ou parental, et contribuer à l’autoguérison?
Travailleuse sociale de formation depuis 35 ans, je suis employée dans le centre de formation professionnelle d’un des centres de service scolaire. En 2023, je suis tombée en congé maladie de longue durée à cause d’épuisement personnel et professionnel. Pendant la période de la COVID, en plus de mon travail très exigeant et de mon problème d’insomnie chronique depuis dix ans, j’ai poussé mes capacités à bout pour gérer la vie quotidienne familiale, les événements stressants (maladies, décès de mes proches, séparation, déménagement, problème de logement, problème financier… bref, la liste est longue). Malgré des signes de fatigue, j’ai voulu continuer à travailler et j’ai finalement eu un accident de voiture, et il a fallu gérer le stress post-traumatique… Tous ces éléments m’ont conduite à un premier arrêt maladie d’un mois. Malheureusement, durant ce congé, j’ai dû gérer un autre événement grave et stressant. Malgré les conseils de mon médecin, j’ai repris le travail sans repos et, après quelques mois à peine, je suis de nouveau tombée en congé maladie… j’avais épuisé toutes mes ressources et mon corps est tombé en panne… La première année de mon congé, la vie était en pause. Mon corps ne pouvait plus bouger. Il y a eu un relâchement total du corps et du cerveau. Il y avait une vie autour de moi et j’étais juste une spectatrice, présente uniquement physiquement. Le lien d’amour et de soin qui nourrissait mon enfant était brisé. Je devais trouver de l’aide et des solutions pour me sortir de ce tourbillon afin de pouvoir prendre soin de mon enfant. Puis, j’ai commencé à participer à des ateliers d’autosoin et d’autoguérison, ayant une forte croyance en la force d’autonomisation des individus. Malgré mon problème cognitif fonctionnel, j’ai trouvé différents moyens de m’informer grâce à plusieurs ressources scientifiques en écoutant des conférences, des symposiums, des vidéos en ligne et en m’informant sur le processus physiologique, neurologique et psychologique de l’épuisement. Une fois que j’ai compris le mécanisme neurophysiologique et psychologique de mon problème de santé, j’ai pu canaliser mes efforts vers des traitements et des thérapies mieux adaptés à ma réalité. Je crois fortement que ma démarche a été bénéfique pour les professionnels qui travaillent avec moi. Une personne qui a suffisamment de connaissances sur son état de santé peut mieux collaborer avec le personnel de soin. Je me demande donc : les personnes vivant des situations similaires peuvent-elles se rétablir plus rapidement grâce à une meilleure compréhension de leur état ? Cela représenterait un coût moindre pour le système de santé. Et surtout, les enfants retrouveraient leurs mères en santé, ces sources de vie qui les guident dans leur cheminement, sans avoir à être témoins de leur souffrance. Voilà ce qui me motive à chercher une approche scientifique de prévention de l’épuisement.
Comment les citoyens peuvent-ils mieux comprendre l'impact social de leurs contributions fiscales afin de se sentir plus investis dans le système fiscal ?
Chaque année, je remplis ma déclaration d’impôts sans avoir une idée précise de l’affectation de mes contributions et de la manière dont elles bénéficient à la société. Je me pose des questions. Comment le gouvernement décide-t-il du montant à consacrer aux programmes linguistiques, aux soins de santé, aux infrastructures ou à d’autres biens publics ? En tant que contribuable individuelle, je n’ai aucun moyen direct de vérifier que le montant que je paie est juste ou d’évaluer la valeur de mes contributions. Ces incertitudes m’amènent à considérer la fiscalité davantage comme un devoir inévitable que comme un investissement dans notre avenir collectif.
Comment repenser nos modèles de gouvernance pour les rendre réellement performants, inclusifs et capables de répondre aux problématiques sociales contemporaines au-delà des structures héritées de la Révolution tranquille ?
Forte d’un parcours à la croisée de la gouvernance publique, de la performance organisationnelle et de la transformation, je m’intéresse depuis plusieurs années aux mécanismes qui rendent les systèmes efficaces ou, au contraire, rigides.
Ma démarche s’inscrit dans une volonté de comprendre comment concilier performance, sens et impact collectif, en plaçant les citoyens au cœur de la décision publique.
Je me suis intéressée à cette question en observant, au fil de mon parcours, le décalage entre les structures publiques héritées de la Révolution tranquille et les besoins actuels de la société.
Ce qui me motive, c’est une conviction née de l’expérience : on ne peut pas transformer une société avec des structures pensées pour un autre temps.
Ayant évolué dans des milieux publics et organisationnels souvent marqués par la lourdeur des processus, j’ai mesuré combien la volonté d’agir se heurte parfois à la rigidité des systèmes.
Je souhaite explorer, avec un chercheur ou une chercheuse, comment rendre nos systèmes de gouvernance plus agiles, plus inclusifs et plus performants, afin que la décision publique soit à nouveau au service du bien commun.
Ma motivation est profondément liée à l’idée de réconcilier performance et sens, en rapprochant la science, la décision publique et l’expérience humaine.
Comment les médias influencent notre perception des handicaps ?
Devenir monitrice en natation adaptée a complètement transformé ma vision du handicap. J’ai réalisé à quel point notre société infantilise énormément les personnes handicapées et reproduit du capacitisme (abélisme)au quotidien. Dans les médias, on les présente souvent sous deux angles extrêmes : soit comme des héros inspirants, soit comme des figures de pitié. Pourtant, le handicap ne devrait pas être perçu à travers ces stéréotypes de société.
Les personnes handicapées ne sont pas des modèles de courage ni des sources de “consolation » pour les autres. Ce sont des individus complets, avec leurs besoins, leurs émotions et leur complexité, comme n’importe qui. Les commentaires du type « Oh, mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais ! », lorsqu’une personne partage sa vie au quotidien, traduisent une ignorance bien ancrée. Mais la réelle question est pourquoi ces préjudices? D’où sortent-ils? Mon hypothèse est que les médias jouent un rôle énorme dans notre vision du handicap, ce qui m’a amené à me poser la question suivante: comment les médias influencent-ils notre perception du handicap ?
Quelles approches innovantes pourrait-on appliquer pour retisser un véritable filet social, bienveillant, durable et surtout accessible autour des enfants les plus vulnérables du Québec?
Depuis une quinzaine d’années, j’accompagne une famille de six enfants issues de l’immigration et leurs parents, allophones et analphabètes dans leur langue d’origine,
dans notre société occidentale, lettrée et organisée. Au départ comme bénévole à la DPJ, jumelée à un des enfants, puis, à titre indépendant, une fois celle-ci retirée du dossier, je suis devenue accompagnatrice, lectrice, animatrice d’activités, traductrice, médiatrice auprès des écoles, des services de garde, de santé et sociaux, des propriétaires, et j’en passe, et ce, pour tous les membres de la famille. Par cette expérience terrain unique et inédite, j’ai été un témoin privilégié des interventions, mais également des limites et des lacunes des nombreux organismes, institutions, réseaux et services mis à la disposition des membres de cette famille, à toutes les étapes de leur intégration au Québec, à tous les stades de développement de leurs enfants et dans à peu près toutes les sphères de leur vie.
Mes constatations rejoignent celles énoncées dans les deux principaux rapports sur l’état des lieux concernant les enfants: Un Québec fou de ses enfants (1991) et le rapport de la Commission Laurent, intitulé Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (2021).
Dans le premier, le père du rapport, Camil Bouchard, dit que «depuis trente ans, on a créé les services, mis sur pied des plans d’intervention et puis on s’est assis derrière nos bureaux en attendant les clients… qui ne sont pas venus».
Dans le second, les commissaires avancent que les recommandations de la Commission Laurent sont en fait une réactualisation des recommandations émises dans le rapport Un Québec fou de ses enfants au sujet de la négligence parentale et communautaire.
En fait, ces rapports révèlent que, depuis plus de trente ans, les problèmes de négligence et leurs solutions ont été identifiés, analysés, documentés, testés et validés, mais force est de constater que leur application fait encore défaut, laissant les parents les plus vulnérables et leurs enfants dans un vide aux conséquences inacceptables en 2025.
C’est pourquoi j’aimerais, dans le cadre du projet Engagement, explorer avec des chercheurs des pistes d’approche innovantes, mesurables et pérennes pour retisser ce réseau autour des enfants et de leur famille, afin de prévenir la négligence parentale et communautaire. Ce fléau insidieux perturbe dès leur plus jeune âge nos enfants, affectant leur développement global et compromettant leur avenir.
Comment notre société évolue-t-elle sur le sujet de l'effort, du goût de l'effort, du travail, du travail bien fait ?
Est-ce que le goût de l’effort est en train de disparaître ? Si oui quelles en sont les causes ? Est-ce que c’est issu de l’éducation parentale, l’éducation scolaire, l’automatisation de la reconnaissance immédiate, les enjeux de gestion des émotions des jeunes, etc. ?
Quels en sont les impacts actuels et futurs, que ce soit sur la santé humaine individuelle, mais aussi sur nos sociétés (productivité, aboutissement de projets, dépassement, satisfaction du travail bien fait, progrès, persévérance, etc.)?
Y a-t-il une tendance réelle à ne plus vouloir faire d’efforts? L’effort est-il devenu une corvée? Comment évoluent la perception et la valorisation de l’effort dans notre société contemporaine? Quelles sont les causes et les conséquences de cette évolution sur les individus (santé, persévérance, satisfaction, bonheur) et sur la collectivité (productivité, innovation, progrès) ?
Je pose cette question, car j’ai été complètement estomaquée, lors de la lecture du livre Le stress au travail versus le stress du travail de Sonia Lupien. À un endroit, il est fait référence à une étude au cours de laquelle on demandait à des gens de choisir entre réfléchir en profondeur à une question pendant 15 minutes ou s’auto-infliger des chocs électriques pendant 15 minutes. 67 % des gens ont choisi les chocs électriques !
Également, l’article dans La presse sorti l’an dernier Peux-tu le faire à ma place? vient renforcer ces questionnements.
Comment la pair-aidance peut-elle bonifier, en complément des services institutionnels existants, le processus de rétablissement et de réintégration sociale des survivantes de violences intimes vivant avec des séquelles psychosociales limitantes?
Ma question émane directement de mon expérience personnelle en tant que survivante de violence intime (psychologique, physique, financière et contrôle coercitif) ayant dû naviguer seule dans le système pendant des années. En attente de services psychologiques et vivant avec un diagnostic tardif de stress post-traumatique complexe, j’ai été confrontée à un paradoxe cruel : alors que j’étais en état de dysfonctionnement dû au trauma et à l’isolement social, je devais moi-même chercher et organiser mes démarches d’aide dans un système fragmenté où l’information n’est pas partagée de façon proactive. Le CAVAC se concentre sur l’accompagnement juridique, mais les besoins en soutien psychosocial et en navigation du système restent largement non comblés pour les survivantes.
C’est au cours de mes propres recherches que j’ai découvert la pair-aidance, et je me suis immédiatement questionnée sur la raison pour laquelle ce principe n’est pas mieux connu ni mieux intégré dans le parcours des survivantes. Je suis actuellement en démarche pour suivre la formation reconnue en pair-aidance au Québec, motivée à la fois par mon propre cheminement de rétablissement et par la volonté profonde de soutenir d’autres personnes vivant avec des limitations liées à la santé mentale. Je crois fermement que l’accompagnement par des pairs ayant traversé les étapes de reprise de pouvoir pourrait offrir ce qui manque cruellement : un soutien émotionnel basé sur l’expérience vécue qui brise l’isolement, combat la honte et la culpabilité, et donne de l’espoir concret.
En collaborant avec un chercheur ou une chercheuse, j’espère contribuer à documenter les besoins réels des survivantes et à démontrer la pertinence d’intégrer la pair-aidance dans leur parcours de rétablissement. Cette approche a déjà prouvé son efficacité dans le domaine de la santé mentale, notamment en toxicomanie et en contexte de psychose, où elle est reconnue pour ses apports significatifs au rétablissement et à la navigation dans les services interdisciplinaires. Pourquoi, alors, cette expertise par les pairs demeure-t-elle absente du soutien offert aux survivantes de violence intime, qui vivent des séquelles traumatiques tout aussi complexes ? Cette recherche pourrait non seulement démontrer comment l’accompagnement par les pairs accélérerait le rétablissement et réduirait les coûts sociaux, mais aussi proposer des pistes concrètes et réalistes pour intégrer cette pratique dans l’écosystème de services existants. J’aspire à ce que cette collaboration produise des connaissances qui transformeront l’expérience des femmes isolées qui doivent actuellement naviguer seules dans un système qui ne tient pas compte de l’impact du trauma sur leurs capacités fonctionnelles, et qu’elle ouvre la voie à des recommandations applicables pour une reconnaissance formelle de la pair-aidance comme composante essentielle du soutien aux victimes.
Quel est l’impact sur la qualité et la pérennité des services aux personnes citoyennes, ainsi que sur le sentiment d’appartenance de ces personnes, à la suite des regroupements et de la mutualisation des organismes et institutions, par exemple, lors du regroupement de municipalités?
Certaines de nos organisations ou institutions régionales, dans le but de maintenir la qualité des services aux citoyens, se sont engagées dans un processus de regroupement ou de mutualisation afin de préserver leur identité et leur mission d’origine. À quels défis ou enjeux auront-elles à faire face pour que leur mission demeure pérenne au-delà des changements de gouvernance au fil du temps? Comment l’histoire et les différents acteurs du milieu peuvent-ils nous aider à développer une vision commune et partagée dans le but de respecter leur raison d’être?
Ce qui me motive au plus profond, c’est d’assurer une pérennité aux gestes ou aux actions que l’on pose aujourd’hui pour assurer un meilleur futur, en termes de coopération et de bien-être de nos organisations et de nos institutions, à l’intérieur évidemment de leur mission tout en sachant s’adapter aux cycles de la vie.
Comment les pratiques collectives ou leur absence influencent-elles le vivre-ensemble?
Quels héritages de pratiques collectives les expériences citoyennes au Québec nous ont-elles laissés ? Comment l’existence de ces pratiques (ou leur abandon) influence-t-elle le vivre-ensemble ? En quoi ces pratiques peuvent devenir des leviers de solidarité nous permettant de faire face aux défis sociaux et écologiques contemporains ? Dans le domaine dans lequel j’évolue, « l’industrie culturelle », la commercialisation et le succès populaire d’un artiste ou d’une œuvre prennent souvent plus de place dans l’appréciation du travail que l’on fait que le sens et l’expérience commune qu’une œuvre tend à créer. C’est un constat qui m’amène à vouloir savoir si c’est un phénomène qui est généralisé dans les différentes sphères d’action de la société québécoise, comment notre rapport au sens et à la collectivité a évolué dans les dernières décennies, et quels sont les mouvements passés et présents qui portent notre capacité de donner du sens à notre existence collective.
Quel est l'impact du règlement sur la fixation des pensions alimentaires sur les enfants placés en centre jeunesse ?
Je suis le parent non gardien de trois enfants, dont le plus vieux a été placé en centre jeunesse à partir de l’âge de 9 ans jusqu’à sa majorité. Tout au long de ces années, j’ai souhaité pouvoir l’accueillir chez moi pour contribuer à sa stabilité. Cependant, mes ressources financières ne me permettaient pas d’accéder à un logement offrant l’espace minimal nécessaire pour envisager son accueil. À la lumière de mon expérience, j’émets l’hypothèse que le calcul de la pension alimentaire pour enfant, présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents, a été l’obstacle systémique principal à mon objectif.
En effet, il m’a été impossible d’en convaincre le tribunal, dans un contexte où, l’autre parent étant représenté par le bureau d’aide juridique. Mes ressources financières limitaient fortement mes possibilités de trouver un avocat de pratique privée disposé à prendre ce dossier complexe. Se représenter soi-même implique un manque de crédibilité devant le tribunal. Cette situation réduisait ma capacité à améliorer mes conditions de logement et, en pratique, empêchait que le développement de mon enfant se déroule en environnement familial.
À mes yeux, cette dynamique a eu un impact direct sur le parcours de mes enfants, en affectant la stabilité et la qualité de la présence de leur père auprès d’eux. Des effets comparables peuvent aussi se manifester chez d’autres enfants lorsque leur parent non gardien dispose de moyens limités. Ces effets deviennent particulièrement déterminants lorsqu’un enfant est placé en centre jeunesse, où tout facteur touchant la continuité des liens familiaux a un impact accru sur son développement. D’où la question suivante : dans quelle mesure le règlement encadrant la fixation des pensions alimentaires influence-t-il, en pratique, le bien-être et les trajectoires des enfants placés?
Cette question touche plusieurs systèmes (législatif, judiciaire, social) et mérite une analyse rigoureuse pour mieux comprendre comment ces mécanismes interagissent et quels effets ils produisent sur les enfants. Je souhaite que cette recherche permette de documenter ces impacts et offre aux décideurs des connaissances utiles pour améliorer les conditions de vie et les perspectives des jeunes concernés.
Pourquoi le monorail ne se développe pas au Québec ?
C’est une technologie d’ici, utilisant des matériaux d’ici, demandant peu d’expropriation, donc économiquement plus intéressante que le chemin de fer de type » tgv « , etc. Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec, avait jadis manifesté son intérêt sans suite.
Comment peut-on soutenir la formation des bénévoles adultes afin de favoriser une intégration bienveillante, formatrice et durable pour toutes les personnes qui s’impliquent?
Ce qui me motive à poser cette question, c’est la volonté de mieux comprendre comment créer des milieux inclusifs et valorisants pour les bénévoles, particulièrement ceux qui vivent une situation de vulnérabilité. Selon l’Institut de la statistique, le tiers des Québécois consacrent du temps et de l’énergie au bénévolat encadré, représentant un total impressionnant de 290,2 millions d’heures offertes à la collectivité. On connait les raisons qui incitent les personnes à faire du bénévolat (contribuer, partager leurs connaissances, soutenir un organisme), tout comme les obstacles (manque de temps, d’occasion ou d’intérêt). Au-delà de ces constats généraux, ma question de recherche porte sur ce qui se passe concrètement au sein des milieux pour soutenir les personnes bénévoles.
D’après mon expérience, j’ai observé que leur engagement des bénévoles dépend de la qualité de l’accueil, de la reconnaissance et du soutien qu’ils reçoivent. Je souhaite donc comprendre comment on peut soutenir la formation des bénévoles afin de favoriser une intégration bienveillante, formatrice et durable pour toutes les personnes qui s’impliquent, particulièrement dans des contextes de vulnérabilité. De cette question principale en découlent d’autres : comment valoriser ce qu’ils savent, compléter leur formation, s’assurer de leur aisance et de leur plaisir à faire du bénévolat.
Santé, qualité de vie, système de santé
Mais moi, qui suis-je? Comment les mêmes gènes transmis depuis des générations s’expriment-ils si différemment ?
C’est une question qui me trotte dans la tête depuis des années. Mes parents ont eu plusieurs enfants avec la même couleur d’yeux, sauf un, mais pas le même groupe sanguin. Quand j’ai fait faire mon profil génétique, je sais que je me retrouve avec un haplogroupe, qui est définit par plein de polymorphismes, d’ADN mitochondrial hérité de mère en fille, alors que l’haplogroupe de l’ADN du chromosome Y est transmis de père en fils. Mes 37 pages de chromosomes remplies de chiffres et de lettres, des gènes qui doivent eux aussi dire de quoi : mes forces, mes faiblesses, ma santé, etc.
Je sais que le Y de mon père, il ne me l’a pas donné, car il le donne seulement à ses fils. Mais pourtant, je ressemble plus à mon père, cela bien plus que certains de mes frères. Je ressemble beaucoup à la mère de ma grand-mère paternelle, etc.
Mes ancêtres paternels et maternels sont pour moi hyper importants, mais qu’est-ce que j’ai d’eux ??? Pourquoi regarde-t-on seulement les lignés MT et Y au lieu de regarder tous les papas et toutes les mamans de chacun d’entre eux et à nouveau regarder encore et encore les 2 parents de chacun d’eux? Quelle est l’importance de ces haplogroupes sur la façon dont mes gènes s’expriment ?
Car je sais très bien que si l’un d’eux, même il y a 400 ans, n’avait pas existé, bien moi, je n’y serais pas non plus. Que me reste-t-il d’eux ? Si cela a été là, j’imagine que ce n’est pas pour rien.
Et voilà. Oui, je veux tout savoir sur moi.
S’il vous plaît, aidez-moi à savoir qui je suis enfin totalement.
Comment l’expérience vécue d’un citoyen ayant transformé un profil psychopathique à risque en trajectoire consciente et prosociale peut-elle être mobilisée pour coconstruire des outils cliniques novateurs en psychopathologie ?
Mon intérêt pour ce sujet est profondément enraciné dans mon parcours de vie. Pendant plus de 30 ans, j’ai dû composer avec une structure de personnalité qualifiée de psychopathique que j’ai réussi à canaliser et à transformer grâce à un long processus de prise de conscience, d’introspection et de travail encadré, notamment par des approches liées aux neurosciences, à la thérapie et à l’analyse comportementale. Mon cheminement m’a permis de développer une compréhension fine — et difficilement accessible de l’extérieur — des mécanismes internes qui sous-tendent ce type de profil, souvent mal compris ou simplement étiqueté.
Aujourd’hui, je suis motivé par le désir de mettre cette expérience au service de la recherche, afin de contribuer à la création d’outils cliniques réellement adaptés à la complexité de ces profils. Je crois fermement que le dialogue entre expérience vécue et savoir scientifique peut ouvrir des pistes de compréhension et de traitement encore inexplorées. C’est pourquoi je souhaite collaborer avec un chercheur ou une chercheuse capable de transformer ce vécu en objet de recherche appliquée, au bénéfice des cliniciens, des institutions… et surtout, des personnes concernées.
Peut-on classer les catégories de personnes atteintes de diabète de type-1 (DT1) en différentes sous-catégories selon leur condition, afin d'offrir un portrait des stratégies thérapeutiques personnalisées auprès des DT1?
Je suis DT1, diagnostiqué au milieu des années 1980, et je m’intéresse depuis quatre années à tous les aspects de cette maladie complexe à comprendre et à traiter.
Il y a environ 60,000 à 70,000 diabétiques de type-1 au Québec, et le tiers d’entre eux maintiennent une glycémie élevée, ce qui les expose à de multiples complications affectant les yeux, les nerfs, les reins et le cœur. Ma démarche s’inscrit dans le désir d’améliorer cette situation en développant un portrait qui servirait à des fins d’amélioration aux mains des DT1 eux-mêmes. Je veux surtout aider les personnes DT1 qui ont l’impression que leur maladie et leur thérapie leur sont personnelles et leur signifier qu’ils appartiennent à une même sous-catégorie de beaucoup de DT1 et ainsi contribuer à réduire leur peur de l’hypoglycémie et leur haut niveau de glycémie, en adoptant un niveau de glycémie davantage situé dans la cible. Mais ce portrait pourra servir à toutes les sous-catégories pour faciliter les efforts de regroupement.
Mes recherches dans ce sens m’ont montré qu’il n’existe peut-être pas actuellement de classification publique complète des sous-catégories. On peut identifier facilement dans la toile plusieurs de ces sous-catégories, mais elles sont toutes présentes individuellement et non sous forme de portrait complet qui nous situerait dans l’ensemble. Quand nous discutons entre nous, nous ne pouvons parler que de notre vécu individuel, sans vraiment comprendre notre profil de thérapie réciproque. Nous ne comprenons pas comment la thérapie des autres DT1 est bien adaptée à leur profil et non à une maladie très personnelle.
Or, différentes sous-catégories nous sont très bien expliquées dans certains sites, comme par exemple, la peur de l’hypoglycémie, la réticence à réduire son hémoglobine glyquée sous les 8,5%, les activités sportives, le travail manuel, le type d’alimentation, les obligations familiales, le niveau d’activité, la résistance ou la sensibilité à l’insuline, le surpoids et l’obésité, les patients et patientes avec complications, la lipodystrophie, la gastroparésie, le LADA, les dépressions ou les épisodes répétés de détresse, et les conditions reliées à la santé des femmes comme le cycle menstruel, la maternité, la préménopause, et la ménopause.
Toutes ces sous-catégories ont déjà un profil de thérapie appliqué à chacun et chacune de nous, mais nous ne savons pas reconnaître ce profil qui nous permettrait d’échanger sur notre vécu. Nos efforts communs de contribution à la santé physique et mentale des DT1 s’en trouvent, par conséquent, fort limités. Nous discutons plutôt de trucs technologiques et de thérapies avancées, sans nous encourager à apporter de légères modifications à notre thérapie. La communauté des DT1 en serait parfaitement apte si on lui facilitait la possibilité de se sous-regrouper autour de profils spécifiques.
D’un autre côté, en tant que patients et patientes et collègues, nous sommes incapables de comprendre si la thérapie décrite par ces mêmes collègues correspond vraiment à la thérapie proposée par leur personnel médical et de nutrition. Antérieurement, j’ai vécu une thérapie où mon spécialiste me traitait plutôt comme un diabétique de type-2, sans poser de question sur mon respect quotidien de la thérapie, sur les obstacles rencontrés dans ma thérapie avec multi-injections, sur ma charge mentale en augmentation à propos de l’adoption de nouvelles technologies comme le capteur de glycémie, la pompe à insuline de première génération ou la pompe hybride, ce qui me laissait isolé pour analyser mes résultats et apporter des correctifs.
Je suis patient-partenaire auprès d’un organisme dédié à améliorer la vie des personnes vivant avec le diabète de type-1 au Canada en s’appuyant sur la recherche. Dans ce cadre, j’utilise mon vécu pour vérifier des études en cours qui sont produites par des chercheurs universitaires. Ce qui me manque pour mieux contribuer, c’est la compréhension de la méthode scientifique appliquée à l’analyse de données de ce registre de patients et patientes. Avec ce projet de classification, je pourrais en faire l’apprentissage pour identifier des sous-catégories, les filtrer et les regrouper autour de thérapies spécifiques. Je possède de bonnes notions scientifiques, mais je n’ai aucunement la compétence pour développer ces différents volets et je compte sur le travail en duo avec un ou une spécialiste du domaine du diabète de type-1 pour acquérir la méthode scientifique et l’appliquer à ce type de recherche.
Comment les outils technologiques peuvent permettre une meilleure indépendance et contribuer au bien-être des personnes polyhandicapées ?
Mon frère à une paralysie cérébrale. Il a un profond désir d’indépendance et d’interaction avec les autres. Il aime énormément les technologies et a été à l’Université pendant une quinzaine d’années pour satisfaire sa soif d’apprendre. Il a eu la chance de compléter plusieurs mineures dans diverses disciplines. Ces dernières années, il tente, par lui-même, d’entrer en contact avec diverses personnes qui pourraient lui permettre d’augmenter son indépendance en étant à la fine pointe des technologies. Il a eu la chance d’entrer en contact avec plusieurs ressources très intéressantes. Ceci lui a permis d’être à la fine pointe des technologies de la communication avec détection visuelle et de l’utilisation de jeux vidéo. Nous avons aussi eu la chance d’être des ‘’early adopters’’ d’une toute nouvelle technologie de casque pour lire les vibrations du cerveau. C’est une opportunité très excitante. Malgré que les technologies aident énormément au développement de mon frère, il est par contre très difficile d’assurer un suivi, car toutes ces technologies vont dans des directions différentes et nous n’avons pas accès aux plus récentes innovations.
Quels sont les mécanismes biologiques et neurologiques qui déclenchent l’éternuement lors d’un rhume, et comment s’explique l’arrêt soudain de ce réflexe dans l’organisme?
Je voudrais qu’on explique pourquoi on éternue sans contrôle et plusieurs fois de suite quand on a un gros rhume. Je ne comprends pas ce phénomène.
Quel est l'impact de la saisonnalité et ses variations de luminosité sur la santé mentale et le sommeil des Québécois?
Collaborer avec un chercheur ou une chercheuse offre plusieurs avantages :
Profiter de son expertise et de ses connaissances spécialisées.
Accéder à des ressources et des données scientifiques de qualité.
Élaborer une méthodologie de recherche rigoureuse et fiable.
Diffuser les résultats du projet et contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine.
Lorsque je participe à des danses en communauté, je constate que cela permet d'accéder à un état particulier de conscience et de mieux gérer le stress de la vie en général. Comment comprendre ce phénomène?
La danse que je pratique en communauté (danse extatique, contact impro, danses traditionnelles…) a changé ma vie. Ça m’a permis de m’exprimer d’une façon libre et intuitive, et de trouver ma véritable expression. J’observe que ces espaces sécuritaires facilitent la transformation et la guérison pas seulement pour moi, mais pour les gens autour. Je trouve que ces environnements sont rares, précieux, et ont un vrai potentiel de changer la vie des gens. Je me demande quels éléments permettent cette transformation et comment on peut utiliser ces espaces libérateurs pour aider plus de gens à accéder à leur expression corporelle, à leur connexion à soi, et à la gestion de leur stress pour un meilleur bien-être.
Je ne comprends pas encore cet état particulier de conscience auquel j’accède lors de ces danses, et je suis curieuse de mieux connaître ce phénomène. Qu’est-ce qui se passe dans le cerveau et le corps quand on danse librement en communauté et qu’on se permet de se connecter à soi et aux autres d’une façon spontanée et authentique? Pourquoi est-ce que ça change notre relation à notre corps, à notre mental et aux autres? Comment ce phénomène peut être appliqué d’une manière plus globale pour améliorer la santé mentale? Je suis passionnée par ce sujet et j’aimerais l’étudier d’une façon rigoureuse avec un chercheur ou une chercheuse pour apprendre les méthodes et la théorie qui existe et pour savoir si des scientifiques se sont déjà posés la question.
La collaboration avec le monde de la recherche permettra de répondre à ces questions, d’investiguer les communautés de danseurs et d’entendre le discours de plusieurs personnes. En tant que danseuse, je peux introduire le ou la chercheuse dans ces environnements. De mon côté, j’ai toujours voulu pousser davantage le pourquoi de mes réflexions, apprendre à réaliser une étude et comprendre le monde de la recherche. Cette opportunité rend accessible le monde de la recherche qui me semblait inaccessible avant.
Comment améliorer la connaissance de fibromyalgie et de ses symptômes au sein du corps médical pour une meilleure prise en charge des patients ?
Mon engagement est de mieux outiller les médecins et les professionnels, tels que les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et bien d’autres dans la prise en charge des personnes qui souffrent de fibromyalgie.
Comment augmenter la qualité et la fiabilité des tests salivaires maison lors de l'utilisation de traitement par hormones bio-identiques afin de faciliter l'ajustement du dosage ?
Souffrante d’un déséquilibre hormonal diagnostiqué vers la trentaine avec un fibrome utérin et des saignements abondants, j’ai opté pour l’hormonothérapie. Cependant, le dosage est extrêmement difficile dans mon cas (plusieurs hormones doivent être dosées) avec des douleurs parfois sur plusieurs semaines. J’ai l’impression que je devrais personnaliser le dosage tout dépendant des phases de mon cycle. Les prises de sang et suivis coûtent cher et sont difficiles à effectuer au bon moment. J’ai cru comprendre qu’il existait des tests salivaires, mais des preuves restent à faire sur certains aspects tels que la fiabilité et l’analyse effectuée en laboratoire. C’est ce qui motive ma question.
Quels sont les besoins d'accompagnement psychosocial des Québécoises et des Québécois issus de la procréation assistée avec la contribution d’un tiers sur la question des origines ?
En tant que personne conçue par don de gamètes, je me suis intéressée à tout ce qui entoure la procréation assistée depuis le début de mon adolescence. Cela représente une part importante de mon identité. Au fil des années, j’ai constaté que la procréation avec la contribution d’un tiers était rarement abordée du point de vue des personnes qui en sont issues, tant au niveau politique que dans la recherche. Récemment, le Québec a légiféré en faveur du droit des personnes conçues par procréation assistée à la connaissance de leurs origines. Le Code civil du Québec prévoit maintenant que « des services d’accompagnement psychosocial soient offerts à toute personne qui entreprend une démarche pour recevoir communication des renseignements et des documents auxquels elle a droit de même qu’à toute personne visée par la démarche […] » (art. 542.9 C.c.Q.).
Mon expérience m’a appris que très peu de professionnels sont en mesure d’offrir un accompagnement psychosocial adéquat pour les personnes issues d’une procréation assistée. Il est crucial selon moi que la recherche se penche sur ce sujet afin de planifier des interventions qui pourront être pertinentes et bénéfiques pour les personnes qui demandent ce service.
Quels sont les obstacles qui nuisent ou empêchent une prise en charge efficace du syndrome génito-urinaire de la ménopause, lorsque celui-ci est secondaire aux traitements oncologiques chez les personnes atteintes d'un cancer du sein ?
Dans la quarantaine, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein hormonodépendant. Les traitements actifs que j’ai dû suivre (mastectomie partielle, chimiothérapie, radiothérapie et ovariectomie) ont été suivis d’une hormonothérapie prescrite pour une durée de sept ans visant à réduire les risques de récidive en modulant les taux hormonaux, notamment celui des œstrogènes.
Ce parcours thérapeutique a entraîné une ménopause précoce et provoqué les symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ce syndrome affecte profondément ma qualité de vie. Comme de nombreuses femmes ayant traversé un cancer du sein et qui vivent avec les symptômes du syndrome génito-urinaire, je me heurte à un manque de reconnaissance et de soutien de la part du personnel soignant concernant ces effets secondaires pourtant bien connus.
Alors que des traitements existent et que les données scientifiques tendent à démontrer leur sécurité, même chez les patientes ayant eu un cancer du sein, leur accès reste limité, tardif ou absent. Ce constat me pousse à tenter de comprendre quels sont les freins à la prise en charge précoce de ces effets secondaires qui affectent la qualité de vie de plusieurs femmes qui, comme moi, ont traversé un cancer du sein.
Quelles stratégies concrètes peuvent être mises en place pour améliorer la reconnaissance, le diagnostic et la prise en charge de l’encéphalomyélite myalgique (EM/SFC) par les médecins généralistes au Québec, en tenant compte des obstacles cliniques, organisationnels et éducatifs ?
Selon l’Association québécoise de l’encéphalomyélite myalgique du Québec (AQEM), il y aurait plus d’un demi-million de personnes atteintes d’EM au Québec depuis la COVID. Or, le monde médical ignore tout de cette maladie et ne s’y intéresse pas, si bien que les malades sont laissés à eux-mêmes face à cette maladie chronique, complexe, multi systémique et handicapante. Les spécialistes en médecine interne ne font que le diagnostic officiel et retournent les patients à leur généraliste. Ces derniers ne connaissent pas la maladie et malheureusement c’est une infime minorité qui s’y intéresse et se documente. Les malades vivent de nombreux deuils en raison de l’énorme épuisement quotidien, de nombreuses douleurs articulaires et musculaires et d’autres symptômes : travail, vie sociale, autonomie, passions, capacité de s’occuper d’eux-mêmes et de leur logement, etc.
Comment un traumatisme émotionnel ou physique vécu dans un contexte impliquant un animal pourrait-il agir comme facteur déclencheur d’une réaction allergique à cette espèce ?
J’ai lu que les personnes les plus susceptibles de développer des allergies aux animaux de compagnie sont celles qui sont régulièrement en contact avec eux. Pour ma part, ayant grandi sur une ferme, entouré de divers animaux domestiques (vaches, chevaux, chats, chiens), je me suis toujours demandé pourquoi ni moi, ni aucun membre de ma famille, ni nos voisins ou nos amis vivant également avec des animaux n’avons jamais développé d’allergies.
À l’opposé, j’ai connu une collègue de travail qui, après avoir longtemps pratiqué l’équitation, est devenue soudainement incapable de s’approcher d’un cheval sans déclencher de fortes réactions allergiques, alors que cette activité était sa passion.
Ayant toujours été intéressé à comprendre l’origine des choses, je lui avais demandé depuis quand elle souffrait de cette pathologie. Sur le coup, elle n’a pas su quoi répondre, mais après réflexion, elle s’est rappelé que 25 ans plus tôt, lors d’une visite à la cabane à sucre près d’un attelage de chevaux, elle avait eu une grosse dispute avec sa meilleure amie. Depuis, elles ne se parlaient plus. Après cette prise de conscience, elle a remarqué que ses symptômes allergiques en présence de chevaux avaient complètement disparu.
Cette histoire m’a toujours intrigué et m’amène à me demander s’il ne s’agit d’un simple hasard ou d’une certaine probabilité. C’est pourquoi, au nom des personnes atteintes de cette pathologie, je pose ma question, afin de vérifier scientifiquement l’hypothèse que le déclenchement d’une allergie à une espèce animale pourrait être lié à un choc ou à un traumatisme émotionnel ou physique vécu en présence d’un spécimen de cette espèce.
Est-ce que la combinaison d’un sommeil prolongé, d’une baisse de la température corporelle et de l’utilisation de chambres hyperbares peut favoriser la régénération de la myéline chez les personnes atteintes de sclérose en plaques ?
J’ai la sclérose en plaques secondaire progressive (SeP-SP), c’est ma motivation, mais j’ai aussi 3 enfants et j’aimerais bien que cette maladie puisse être guérie pour les générations à venir. Les lectures que j’ai faites et les protocoles de recherche auxquels j’ai participé m’ont amené à poser cette question.
Étant donné l’incidence élevée de la sclérose latérale amyotrophique au Québec et les soupçons de facteurs environnementaux, comment renforcer la documentation et l’analyse de cas afin d’identifier des liens possibles avec des polluants ou des conditions environnementales et ainsi d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche ?
Mon questionnement vient de différents constats. Le taux d’incidence de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a augmenté au Québec de façon significative et serait même deux fois supérieur à ce qu’on peut voir ailleurs en Occident (source: Mme Isabelle Goupil, directrice de la Santé publique dans la Capitale-Nationale). Suite au décès de mon grand ami de la SLA l’an dernier, à l’âge de 69 ans, sa conjointe m’a témoigné de son exposition probable à des polluants chimiques dans une usine d’impression de t-shirts. Aussi, l’émission Enquête d’octobre 2025 pointait les cyanobactéries comme cause possible ainsi que les émissions de l’usine Domtar de Windsor et la possibilité d’effets cumulatifs. Le fait que mon ami habitait à proximité d’une usine semblable à Limoilou (White Birch). Enfin, je suis retraité et disponible à donner de mon temps pour une telle cause. Je ne pourrais jamais envisager de faire ça seul, le programme Engagement m’apparaît donc une voie extrêmement intéressante, grâce à la possibilité de m’adjoindre un chercheur ou une chercheuse.
Pourrait-on trouver un lien entre les infections d’origine alimentaire comme Listeria monocytogenes, E. coli, Shigella ou Norovirus et la détérioration physique ou cognitive observée chez les personnes en situation d’itinérance à Montréal?
Je vis et travaille au centre-ville de Montréal et j’observe souvent la détérioration rapide de la santé de plusieurs personnes en situation d’itinérance. Cela m’a toujours interpellée, car cette dégradation semble souvent aller au-delà de ce que la drogue ou la fatigue peuvent expliquer. J’ai vu une courte vidéo sur une éclosion de Listeria aux États-Unis qui m’a amenée à me demander si des infections similaires pouvaient passer inaperçues ici. Est-ce que ces infections pourraient contribuer à ce déclin au-delà des facteurs connus comme la consommation de substances ou l’exposition aux éléments ?
Après avoir communiqué avec une personne de la recherche, elle m’a confirmé que personne n’avait encore étudié cette question de façon spécifique au Québec et m’a encouragée à la soumettre au programme de recherche citoyenne. Ce projet me motive, car il pourrait mettre en lumière un aspect négligé de la santé publique et aider à mieux protéger les personnes les plus vulnérables de notre communauté.
Comment peut-on mieux soutenir les personnes atteintes de démence et leurs familles, afin qu’elles puissent recevoir un accès opportun aux soins palliatifs ?
Ma motivation pour cette question de recherche est profondément personnelle. Je la pose en mémoire de ma mère, qui a vécu avec la démence et qui, malgré la gravité de sa maladie, n’a jamais pu avoir accès aux soins palliatifs au Québec. J’ai cherché du soutien dans le réseau public, privé et médical, sans jamais trouver de porte d’entrée claire vers ces services, même lorsque son état s’était considérablement détérioré. Les soins palliatifs sont destinés aux personnes atteintes de maladies graves, mais la démence n’est souvent pas reconnue comme telle dans notre système de santé. Ce constat m’a profondément marquée. Je souhaite collaborer avec une personne chercheuse afin de mieux comprendre cette problématique, car ce que j’ai vécu n’est pas un cas isolé : des centaines, voire des milliers de familles au Québec font face à la même réalité. Alors que le nombre de personnes vivant avec la démence ne cesse d’augmenter, il est urgent de comprendre et de surmonter les obstacles qui limitent leur accès aux soins palliatifs.
Comment tirer parti des leçons de la pandémie de COVID-19 pour s’assurer que, lors de futures crises sanitaires, les besoins des personnes en situation de handicap soient réellement pris en compte ? Quelles pratiques exemplaires devraient être consolidées ou développées en ce sens ?
Côtoyant plusieurs familles dont un des membres est autiste, je crois qu’il est important de ne pas répéter les erreurs qui ont été faites lors de la pandémie. Il est important de prendre en compte leurs besoins et de ne pas les considérer comme moins importants que le reste de la population.
Comment la mutation PSMC5 P320R peut-elle perturber le développement et la communication entre les cellules du cerveau chez les enfants porteurs de cette mutation rare ?
Je suis membre de la famille d’une petite fille atteinte d’une pathologie rare associée à la mutation PSMC5 P320R. Cette variation génétique, dont les effets sont encore très mal compris, touche un gène impliqué dans la régulation du protéasome, un système essentiel au bon fonctionnement des cellules, notamment celles du cerveau.
Comme plusieurs familles confrontées à une maladie ultra-rare, nous faisons face à de nombreuses incertitudes concernant l’évolution de la maladie, les mécanismes en cause et les possibilités futures de prise en charge. Or, on ignore totalement comment une telle altération moléculaire peut influencer le développement cérébral ou la communication entre les neurones. C’est pourquoi je souhaite poser la question suivante : comment la mutation PSMC5 P320R peut-elle perturber le développement et la communication entre les cellules du cerveau, et quelles pistes de recherche pourraient aider à mieux comprendre les difficultés observées chez les enfants porteurs de cette mutation rare ?
Cette question vise à susciter une collaboration entre les membres de la famille touchée et la communauté scientifique, afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à cette mutation et, à long terme, d’ouvrir la voie à des approches de recherche ou d’intervention adaptées.
Comment la relation au territoire et les pratiques artistiques, culturelles et intergénérationnelles peuvent-elles soutenir la santé mentale, le mieux-être, ainsi que l’ancrage et la sécurité identitaire des femmes autochtones — incluant les personnes bispirituelles ou neurodivergentes — et inspirer des approches en santé plus culturellement adaptées et inclusives ?
Je me situe personnellement à l’intersection de plusieurs réalités : je suis une femme Wendat, noire, bispirituelle et neurodivergente. Mon parcours a été marqué par l’errance médicale, par des approches en santé souvent déconnectées de nos réalités culturelles et identitaires et par l’absence de reconnaissance du territoire comme partie intégrante de nos façons de guérir. En vivant au sein de ma communauté, j’observe une détresse psychologique profonde chez de nombreuses femmes autour de moi. Trop souvent, nos systèmes de santé échouent à nous voir, à nous entendre et à nous accueillir telles que nous sommes, dans toute la complexité et la richesse de nos histoires.
Je suis convaincue que la relation au territoire et les pratiques artistiques et culturelles portent un potentiel immense de mieux-être, particulièrement lorsqu’elles sont mises en dialogue avec la psychologie moderne. Cette intuition, ancrée dans mon vécu et dans ce que j’observe autour de moi, demande maintenant l’appui d’une démarche scientifique rigoureuse. C’est ce qui m’amène à vouloir collaborer avec un chercheur ou une chercheuse pour transformer une conviction éprouvée sur le terrain en connaissances solides, utiles et transférables.
Alors que les communautés autochtones sont encore frappées par des taux de dépression et de suicide alarmants, je crois qu’un travail sur l’identité, l’ancrage, la sécurité culturelle et le lien au territoire peut contribuer à la prévention, à la résilience et à la guérison. On parle souvent de réconciliation au Québec, mais tant qu’on ne prendra pas soin de la santé des femmes autochtones, ce mot restera creux. Ce projet est, pour moi, une façon de prendre soin, de prévenir les violences, incluant celles qui faites aux femmes et personnes bispirituelles disparues ou assassinées, et de participer à la construction d’approches en santé réellement adaptées, humaines et durables.
Comment le toucher (massothérapie, fasciathérapie) pourrait-il aider les personnes âgées à diminuer les dommages bio- et psychosociaux qu’engendrent l’isolement et la solitude, tout en maintenant ou en améliorant leur flexibilité et leurs mouvements articulaires afin de prévenir la raideur et le manque de mobilité?
Étant moi-même massothérapeute, j’ai accompagné mes parents par le toucher dans leurs dernières années de vie. J’aimerais que cette expérience personnelle puisse servir à faire reconnaître ce métier que j’exerce en clinique et en spa depuis 25 ans. J’aimerais qu’on puisse publier des résultats sur les bienfaits du toucher auprès des personnes âgées, considérant que, si le sens du toucher est le premier sens que l’on développe au moment de naître, il est aussi le dernier que l’on perd en fin de vie. On encourage les nouveaux parents à toucher leur bébé et pratiquer le peau à peau. On pense encore parfois qu’en vieillissant on a moins besoin d’être touché. Au contraire. Les personnes âgées ont besoin plus que jamais d’un toucher bienveillant, car elles vieillissent souvent dans l’isolement et que le sens du toucher est susceptible de subir quelques modifications. À cela, nous pouvons ajouter les inconforts et les douleurs physiques qui accompagnent le vieillissement. J’aimerais que cette recherche puisse sensibiliser les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, le personnel des résidences privées pour aînés (RPA), le personnel médical ou toute autre personne étant en relation avec des personnes âgées de l’importance du toucher. Selon la tendance au Québec, environ 1 personne sur 4 sera âgée de 65 ans et plus en 2031.
Pourrait-on coconstruire une approche d’enseignement en ligne qui offre un environnement psychologiquement sain, sécurisant, inclusif et qui favorise le développement de l’autonomie des patients dans leur parcours vers et après une chirurgie bariatrique?
J’ai eu recours à une chirurgie bariatrique en 2022, après avoir été sur la liste d’attente pendant quatre ans. Malgré mon implication active dans toutes les rencontres préparatoires et de suivis, je ressens encore un manque de soutien et d’accompagnement. Pour favoriser le maintien et la consolidation des saines habitudes essentielles à la réussite de cette démarche, un outil de soutien cocréé par des professionnels de la santé qualifiés et des patients vivant la réalité de la chirurgie bariatrique permettrait de mieux répondre aux besoins réels de milliers de Québécois.
Comment les patients peuvent obtenir les connaissances et les habiletés nécessaires pour mieux se préparer et être plus efficace lors de consultations médicales afin de recevoir les soins les plus appropriés en temps opportun tout en maintenant une étroite relation thérapeutique ?
J’ai de la difficulté à poser mes questions lors de mes consultations médicales et j’ai l’impression que d’autres personnes ont le même problème. J’aimerais faire en sorte que ce soit plus facile pour les autres lorsqu’ils rencontrent leur docteur et qu’ils se sentent plus confiants. Il y a très peu de temps pour parler avec nos docteurs à propos de ce qui ne va pas bien quand on les rencontre. Je vis avec différents handicaps et je comprends que c’est compliqué. J’aimerais aider les autres et que plus de personnes soient conscientes des problématiques auxquelles nous faisons face comme patients.
Urbanisme
Aucune question dans cette catégorie
Questions proposées par les citoyennes et citoyens antérieurement
Vous pouvez aussi consulter les questions des concours précédents pour vous inspirer: