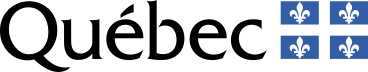Responsable :
Sophie Lerouge
Établissement :
École de technologie supérieure (ÉTS)
Année de concours :
2024-2025
Sophie Lerouge, responsable, École de technologie supérieure
Ali Ahmadi, cochercheur ou cochercheuse, École de technologie supérieure
Ahmed Fatimi, chercheur principal ou chercheuse principale – international, Université Sultan Moulay Slimane
Gilles Soulez, cochercheur ou cochercheuse, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Secteurs de la recherche : Sciences de la santé; Sciences naturelles et génie
Domaine : Matériaux
Table des matières
1. RÉSUMÉ DU PROJET
CONTEXTE :
Les traitements médicamenteux locaux (anti-douleurs, anti-inflammatoire, anti-cancéreux), réalisés par les radiologues dit « d’intervention » à l’aide de fines aiguilles ou tubulures sous imagerie à rayons X, ont connu une forte augmentation ces dernières années dans les pays occidentaux. Cependant, lorsque le médicament est injecté seul, il se libère trop rapidement dans les tissus. L’intégrer à une matrice permet de mieux contrôler la libération. Dans certains cas, ces matrices agissent également comme agents embolisants permettant de bloquer les flux sanguins indésirables, notamment dans le traitement des saignements post-partum, des malformations vasculaires, des fibromes utérins et de certains cancers. Ces matrices doivent répondre à de nombreux critères pour être injectables, posséder une radiopacité suffisante pour suivre l’injection, offrir une résistance mécanique aux contraintes physiologiques, libérer les médicaments de façon progressive et bien sûr garantir une biocompatibilité optimale pour les patients.
Il existe quelques agents embolisants commercialisés, mais ils sont extrêmement chers et non abordables pour les marchés émergents comme le Maroc. Les hydrogels à base de biopolymères sont particulièrement prometteurs comme agents embolisants injectables, chargés ou non en médicaments, et plus généralement pour les applications biomédicales et l’ingénierie tissulaire. Parmi eux, certains peuvent être obtenus à partir des biomasses marocaines abondantes qui sont pour l’instant peu valorisées. Ce projet vise d’une part à utiliser la biomasse marocaine pour générer ces biopolymères et d’autre part à utiliser ceux-ci pour le développement d’agents injectables pour les thérapies minimalement invasives guidées par imagerie.
OBJECTIFS :
Nous développerons ou adapterons les protocoles pour obtenir ces biopolymères à partir des résidus de canne à sucre et des déchets de crevette respectivement et nous formerons des hydrogels intelligents, gélifiants à température et pH physiologiques, pour applications biomédicales. En particulier, nous formulerons des biohydrogels embolisants radio-opaques, chargés ou non en médicaments, et étudierons leur potentiel pour bloquer les flux sanguins indésirables et traiter certains cancers. Les propriétés physico-chimiques, rhéologiques et mécaniques des hydrogels seront analysées. L’injectabilité à travers des cathéters, la pénétrabilité et les propriétés d’occlusion seront évaluées. Une étude préliminaire de la biocompatibilité, de la libération des médicaments et de leur effet sur un modèle tumoral in vitro sera réalisée. Enfin, une démonstration radiologique in vivo évaluera la faisabilité de l’injection, la radiopacité et l’efficacité d’occlusion dans un modèle artériel porcin.
IMPACT :
Ce projet collaboratif aura un impact tant sur l’économie que la santé des populations canadiennes et marocaines. Il favorisera le développement durable basé sur l’économie circulaire tout en étant vecteur d’innovation dans la santé, un domaine à très haute valeur ajoutée. Il contribuera à l’avancement des traitements minimalement invasifs réalisés par radiologie d’intervention. Ces agents embolisants fabriqués à partir de la biomasse marocaine permettront de rendre ces traitements accessibles à une plus grande part de la population dans les pays émergents comme le Maroc. Au Québec, l’ajout de médicaments de pointe chimio-, immuno- ou même radio-thérapeutiques dans ces matrices injectables permettra de dépasser les limites des traitements actuels et d’augmenter les chances de survie et la durée de vie des patients atteints de cancer.